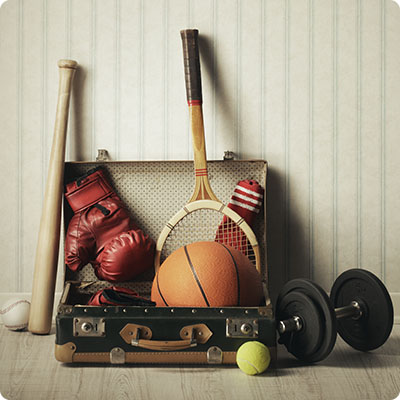La colonisation grecque et la naissance de la Magna Grecia
Les auteurs grecs sont silencieux concernant les raisons qui poussent les Grecs à quitter leur mère patrie pour coloniser de nouvelles terres. La réponse réside certainement dans la crise démographique et agraire qui frappe les cités de la Grèce archaïque : la production agricole ne parvient pas à satisfaire les besoins croissants d’une population en constante augmentation. De plus, les Grecs sont avant tout des propriétaires terriens et, pour éviter la parcellisation et la dispersion des terres, seul le fils aîné hérite du domaine familial. Les cadets doivent choisir entre rester au domaine et travailler pour le compte de leur frère aîné ou bien partir à la recherche de nouvelles terres. Aussi, les cités grecques organisent des expéditions et forment des contingents de colons qui prennent la mer. Le long des côtes italiennes et siciliennes, les colons trouvent un environnement idéal : des plaines côtières fertiles et arrosées de cours d’eau, habitées par de petites communautés trop peu soudées entre elles pour opposer une résistance efficace.
La première colonie du sud de la péninsule est Rhegion (Reggio Calabria), fondée en 730 av. J.-C. par des Eubéens. Quelques décennies plus tard, en 706 av. J.-C., des colons provenant de Sparte et de Laconie fondent Tarente. Ces deux cités constituent les deux extrémités d’un arc côtier bordant la mer Ionienne et le long duquel s’installent les principales colonies grecques. Les Achéens du nord du Péloponnèse fondent Sybaris, Crotone et Caulonia ; de la Locride, en Grèce continentale, proviennent les colons à l’origine de Locres. Métaponte, sur le territoire de la Basilicate, est fondée par des contingents en provenance de Sybaris et de Crotone. Les colons reproduisent le schéma de la polis grecque, la cité-Etat indépendante, et apportent avec eux leur culture, leurs institutions, leur langue et leurs divinités. Les établissements évoluent en des cités prospères qui perpétuent l’hellénisme en dehors du monde égéen. Pendant plusieurs siècles, les peuples autochtones de l’intérieur des terres doivent s’accommoder de cette présence, et ils s’hellénisent progressivement, adoptant l’alphabet, le mode de vie, les formes de l’art grec. Les rapports entre Grecs et autochtones oscillent en fonction des intérêts de chacun : les échanges commerciaux favorisent les rapports pacifiques. Par contre, la propension des cités à étendre leur domination sur l’intérieur des terres pour accroître leur surface agricole entraîne des heurts avec les communautés indigènes.
Tarente est la seule grande colonie grecque d’Apulie (les Pouilles actuelles). L’antique Taras est fondée par les Spartiates au fond d’une anse naturelle propice à l’établissement d’un port, qui deviendra une importante base navale. Les premiers siècles, Tarente cherche à étendre sa domination et rencontre l’opposition farouche des populations locales iapyges, les Messapiens et les Peucétiens. La cité entre aussi en rivalité avec les autres cités grecques de la Magna Grecia. Mais elle parvient à s’imposer et, au IVe siècle av. J.-C., à son apogée, Tarente domine l’Apulie et l’ensemble du golfe. L’influence grecque en Apulie est représentée par la céramique apulienne à figures rouges qui, dérivée de la production attique, s’en démarque pour proposer des vases aux formes recherchées et à l’abondance décorative.
Sur le territoire de la Calabre actuelle, les populations locales sont absorbées voire annihilées par l’arrivée grecque. Sybaris impose son hégémonie sur 25 agglomérations oenôtres et des villages sont abandonnés par leurs habitants. Oenôtres et Ausoniens se retranchent à l’intérieur des terres, dans les zones montagneuses, mais ils nouent des rapports commerciaux avec les Grecs et échangent leurs matières premières (bois, minerais) contre des marchandises et des articles propres à la culture grecque (céramique, produits de luxe). Ceux-ci, mis au jour lors des fouilles archéologiques, se substituent progressivement aux objets représentatifs de l’identité des communautés locales. Aux Ve et IVe siècles av. J.-C., les Lucaniens et les Bruttiens, des populations italiques, s’implantent en Basilicate et en Calabre et s’emparent de plusieurs colonies grecques. Eux aussi succombent à l’attrait de l’hellénisme, et leurs cultes et rites religieux sont en grande partie issus des coutumes grecques, de même que leur production artistique, inspirée des modèles de la Magna Grecia.
Deux musées principaux offrent un panorama bien documenté du rayonnement de la culture grecque dans le sud de l’Italie : il s’agit des musées de Tarente et de Reggio Calabria. Leurs collections archéologiques démontrent que, même si les modèles et l’esprit sont grecs, les artisans des colonies ont développé des productions originales, reflets d’une identité locale, et qui font partie de ce répertoire de la Magna Grecia qui est appelé « italiote » par les spécialistes. On trouve, au musée de Tarente, des pièces uniques comme les « Ors de Tarente », produits du savoir-faire des orfèvres tarentins, et la plus vaste collection de figurines en terre cuite peintes. Quant au musée archéologique de Reggio Calabria, il abrite un riche matériel en provenance des sites et des sanctuaires de la Magna Grecia, avec des productions originales comme celle des pinakes de Locres (des bas-reliefs votifs en terre cuite). Sans oublier les célèbres bronzes de Riace, retrouvés au large des côtes calabraises en 1972.Les vestiges de la Magna Grecia
Les trois régions du sud de l’Italie n’ont pas restitué de vestiges monumentaux d’une ampleur comparable à ceux des sites de Campanie (Paestum) et de Sicile (Agrigente, Ségeste, Sélinonte). Toutefois, les fouilles effectuées en Calabre ont livré un matériel remarquable pour la connaissance de l’architecture de la Magna Grecia : les investigations sur les sites des anciennes colonies grecques ont donné lieu à une étude approfondie des fortifications, des édifices publics, des habitations et des tombes. L’urbanisme des villes, avec leur plan hippodamien aux rues rectilignes se croisant en angles droits, y a été mis en évidence.
Les temples sont probablement les monuments les plus représentatifs du monde grec antique et ceux qui frappent davantage les esprits.
A Tarente, il ne reste du temple de Poséidon érigé au VIe siècle av. J.-C. que deux colonnes doriques qui se dressent sur la piazza del Castello.
En Basilicate, la zone archéologique urbaine de Métaponte conserve les restes partiels de plusieurs temples appartenant à une aire sacrée, dont le temple d’Apollon Licio. Il faut se rendre à 3 km de là, sur le site des Tavole Palatine, pour admirer les imposants vestiges du temple d’Héra : édifié au VIe siècle av. J.-C., il en reste deux rangées de quinze colonnes doriques qui faisaient partie du périptère (la colonnade extérieure).
Sur les sites archéologiques de Calabre, il faut faire un effort d’imagination pour reconstituer l’ampleur des temples à partir des vestiges visibles aujourd’hui : la colonne solitaire du temple d’Héra Lacinia près de Crotone, les socles de pierre sur lesquels s’élevaient les sanctuaires de Locres… Cependant, le matériel mis au jour sur ces sites, et notamment à Locres, est exceptionnel et compte parmi les plus exemplaires de la Magna Grecia : sculptures de marbre ornant les frontons, éléments architectoniques en terre cuite peinte, pinakes ornés de bas-reliefs délicats, des témoignages que l’on peut admirer et replacer mentalement dans leur contexte au musée de Reggio Calabria.Dans l’orbite romaine
A partir du IVe siècle av. J.-C., les Romains se lancent à la conquête du sud de l’Italie. Tarente se sent menacée et fait appel au roi Pyrrhus d’Epire. En 280 av. J.-C., à la bataille d’Heraclea (près de Métaponte), Pyrrhus remporte une importante victoire contre les Romains grâce, notamment, à ses éléphants de guerre qui sèment la terreur dans les rangs ennemis. Un an plus tard, à la bataille d'Ausculum (province de Foggia), les armées de Pyrrhus affrontent à nouveau les légions romaines (qui, cette fois, se sont équipées de dispositifs anti-éléphants !). Pyrrhus est vainqueur malgré de très lourdes pertes humaines, ce qui lui fait dire : « Encore une victoire comme celle-ci et nous sommes perdus ! ». Toutefois, en 275, Pyrrhus est défait à la bataille de Bénévent et repart dans son royaume, laissant la Magna Grecia à la merci des Romains. En 272 av. J.-C., Tarente est soumise et le sud de la péninsule tombe dans l’orbite romaine.
En 216 av. J.-C., lors de la deuxième guerre punique, la région est le théâtre d’une autre bataille majeure, celle de Canne (à 20 km de Barletta dans les Pouilles), qui oppose les troupes d’Hannibal aux légions romaines, encerclées puis mises en déroute par le général carthaginois. Le musée de Canne della Battaglia retrace les différentes étapes du combat et les manœuvres tactiques adoptées par les Carthaginois, tandis qu’une colonne marque le lieu de l’affrontement.
Dès le IIIe siècle av. J.-C., le sud de la péninsule entre dans une nouvelle ère et, même s’il faut du temps pour que la langue latine détrône l’idiome grec, la culture romaine s’impose progressivement, avec ses institutions et sa classe dirigeante latine. Cette culture pénètre aussi la région en suivant les voies romaines qui mettent le territoire en communication rapide avec Rome.
La région des Pouilles, parcourue par la Via Appia (190 av. J.-C.) et par la Via Traiana (109 ap. J.-C.), doit aux Romains quelques-uns de ses plus beaux vestiges. L’aboutissement du parcours de la Via Appia à Brindisi était marqué par deux colonnes : l’une domine toujours la terrasse du port tandis que l’autre a été transférée à Lecce en 1528 pour supporter la statue de Sant’Oronzo, le saint patron de la cité. A Lecce, en outre, les façades baroques cohabitent avec l’amphithéâtre et le théâtre romains. Canosa (Canusium), l’une des cités les plus importantes de l’Apulie antique, est parsemée de vestiges romains : les restes du temple de Jupiter Toro, les thermes Lomuscio, ainsi qu’un bel exemple d’architecture funéraire avec les hypogées Lagrasta, un complexe souterrain creusé dans le tuf et utilisé du IVe au Ier siècle av. J.-C. A proximité du centre, sur le tracé de l’antique Via Traiana (l’actuelle via Cerignola), on rencontre l’arc de Trajan, des mausolées et le pont romain traversant l’Ofanto.
Situé au bord de la mer, le site archéologique d’Egnazia est certainement le plus intéressant de la région. Gnathia était un port florissant, et la visite permet d’identifier tous les édifices caractéristiques d’une ville romaine : le forum, la basilique civile, l’amphithéâtre et la Via Traiana qui traversait la ville, revêtue de pavés.
La Basilicate est relativement moins imprégnée de l’esprit de la Rome antique. Le long de la Via Appia se développent les colonies romaines de Venusia (Venosa) et Grumentum (Grumento Nova). Les parcs archéologiques des deux agglomérations abritent les vestiges romains les plus significatifs de la région : des quartiers entiers ont été mis au jour, avec leurs maisons d’habitation parfois ornées de mosaïques, leurs édifices publics (amphithéâtre, thermes, théâtre) et religieux (vestiges de temples).
Sous la domination romaine, la Calabre occupe une position secondaire et périphérique. Sur son territoire se développent de vastes propriétés agricoles (latifundia) et des villas rustiques éparses. Les sites les plus intéressants sont les thermes de Vibo Valentia, ornés de magnifiques mosaïques polychromes, et les parcs archéologiques de Sibari et de Scolacium (près de Catanzaro Lido). Les vestiges révélés par les fouilles et visibles lors de la visite (restes de théâtres, amphithéâtres, thermes, forum…) démontrent que la romanisation avait gagné l’ensemble du territoire de l’ancienne Magna Grecia.