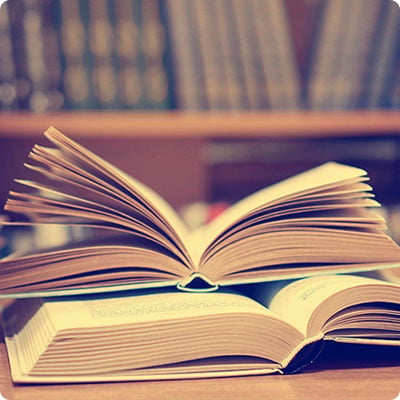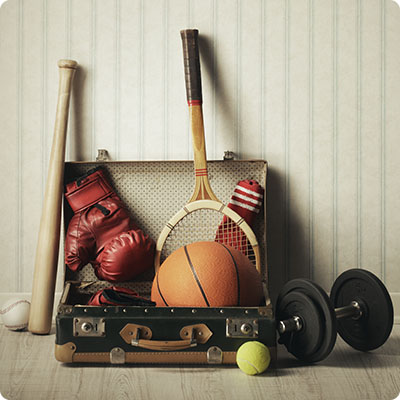Au pays de l’or bleu et de l’or vert : des ressources naturelles abondantes mais menacées
Le Paraguay est traversé de grands bassins hydrographiques qui constituent une ressource en eau abondante. L’aquifère guarani est l’une des plus importantes réserves d’eau douce souterraine de la planète. Présent sur une surface de plus de 1,2 million km², il comprend un volume d’eau d’environ 55 000 km3. Le hic c’est que cette réserve est à cheval sur quatre pays, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, qui ne parviennent pas à une gestion concertée de la ressource, et ce malgré la signature d’un accord en 2010. Il s’agissait de mettre en place une gestion responsable et systémique de l’aquifère, afin de le protéger des pollutions pouvant survenir en amont et ainsi éviter la contamination du milieu aval (mercure issu de l’exploitation de mines boliviennes, charrié par la rivière Pilcomayo, ou glyphosate brésilien issu de l’agriculture, transporté par le río Paraguay). Les gouvernements qui se sont succédé dans les différents pays ne semblent pas faire grand cas de cet accord. L’eau des bassins hydrographiques fait également l’objet de surexploitation. L’eau du bassin de la Plata est ainsi principalement utilisée pour la culture du maïs, du soja et du blé, mais aussi pour la production d’énergie. La centrale hydroélectrique d’Itaipu, mise en service en 1984, à la frontière entre Paraguay et Brésil, est celle qui produit la plus grande quantité cumulée d’énergie au monde. Sa construction et son exploitation ne se sont pas faites sans un lourd coût social et environnemental : déplacement de populations, inondation de forêts et de terres agricoles, submersion de la cascade des Sept Chutes… Le Pantanal constitue la plus grande zone humide du monde. Cette vaste plaine alluviale, qui se situe pour une grande partie au Brésil, mais aussi en Bolivie et au Paraguay, abrite la plus grande diversité de plantes aquatiques du globe et la plus grande densité d’animaux sauvages d’Amérique du Sud. Cet espace naturel est menacé dans sa partie paraguayenne par le projet d’aqueduc Hidrovia, dont la finalité est de faciliter la navigation et de fournir un débouché maritime à la Bolivie et au Paraguay.
Menaces sur les forêts et la biodiversité
La forêt, autre ressource du pays, est vendue à de gros exploitants, principalement pour le pâturage des bovins, et la culture du soja – OGM et traitée aux pesticides. Ces cultures sont destinées au nourrissage du bétail, in situ… mais aussi en Europe. Avec les arbres, véritables puits de carbone, c’est aussi une biodiversité – dont de nombreuses espèces endémiques – qui disparaît de manière souvent irrémédiable. Les peuples autochtones, qui ont vécu pendant des milliers d’années en harmonie dans ces milieux, sont eux aussi chassés. La situation est particulièrement dramatique dans la région du Chaco, longtemps épargnée. Plus largement, les espaces naturels et les ressources du pays sont menacés principalement par les choix de développement en œuvre dans l’ensemble des bassins hydrographiques de la zone : agriculture intensive et élevage, hydroélectricité et extraction minière, qui conduisent à la déforestation, l’érosion des sols, la pollution aux pesticides et aux métaux lourds, et le braconnage. Paradoxe d’un pays riche en ressources, mais sans gestion digne de ce nom, c’est près d’un quart de la population qui n’a pas accès à une eau propre à la consommation. Selon l’ONG Survival International, en 2014, des licences d’exploitation de la forêt, lieu de vie ancestrale des Ayoreo, furent accordées par le ministère de l’Environnement, à une entreprise d’élevage brésilienne, sans respect, ni des populations autochtones ni du classement en réserve de biosphère de l’UNESCO de la zone. Durant le mois d’août 2019, ce furent près de 37 000 ha qui furent ravagés par des feux. L’incendie a touché le Cerrado, le Pantanal et le Chaco paraguayen, affectant des zones protégées, notamment le parc national du Río Negro, la réserve Tres Gigantes et une partie du monument Cerro Chovoreca.
Parcs nationaux et espaces protégés
Le pays comporte encore quelques sanctuaires de biodiversité. Les parcs nationaux raviront les amoureux de nature et de grands espaces, plutôt aventuriers, car ces espaces ne proposent que peu ou pas d’infrastructures touristiques et sont situés dans des zones plutôt reculées. Le Chaco compte ainsi plusieurs parcs nationaux, protégeant les milieux et espèces caractéristiques de la région.
Le Parc national Teniente Agripino Enciso, créé en 1980, abrite dans ses forêts d’épineux pumas et tapirs, mais aussi des variétés de cactus et broméliacées.
Le Parc national Defensores del Chaco, créé en 1975, est le plus vaste en superficie. Il préserve la biodiversité présente dans ses forêts sèches, cactus, mais aussi jaguars, pumas, tapirs et tatous.
Le Parc national Tinfunqué, établi en 1966, abrite au sein de sa zone humide classée RAMSAR des oiseaux migrateurs, canards sauvages, cigognes, mais aussi des paresseux.
Le Parc national du Río Negro, également site RAMSAR, protège une partie du Pantanal et ses écosystèmes : marais et forêts dotés d’une grande diversité floristique et faunistique.
La partie orientale du pays, plus peuplée et plus touristique, permet la visite de plusieurs parcs nationaux, dont certains plus accessibles et souvent plus fréquentés. On citera ainsi :
Le Parc national de Cerro Cora, au nord de Concepción. Situé à la frontière avec le Brésil, le site fut aussi le siège d’une bataille qui mit fin à la guerre de la Triple Alliance, en 1870.
Le Parc national de Ybycui, situé à seulement deux heures et demie de voiture d’Asuncion, permettra au voyageur de découvrir les écosystèmes des forêts humides, de type subtropical et ses magnifiques chutes d’eau.
Le Parc national Vapor Cué, est un site historique ayant pour vocation la conservation des navires de guerre utilisés au cours de la guerre de la Triple Alliance.
La réserve San Rafael, peu fréquentée, abrite pourtant une biodiversité exceptionnelle. C’est aussi une partie du territoire des Mbyá Guarani.
Le voyageur moins aventureux pourra cependant découvrir des réserves privées, apportant à la fois une meilleure réglementation environnementale et mieux aménagées pour l’accueil des visiteurs. On citera notamment la réserve de biosphère Mbaracayú, gérée par la Fundación Moisés Bertoni ou encore les réserves écologiques d’Itaipú.