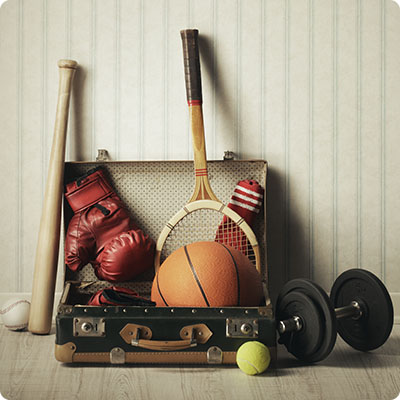Le campanilismo, phénomène régional
Les Italiens se sentent tout d’abord liés à leur ville ou à leur région, plutôt qu’à leur pays. Un phénomène que l’on appelle campanilismo (de campanile, clocher, soit être fidèle au clocher de son village ou encore avoir l’esprit de clocher). Dans les Alpes italiennes, région frontalière, ce chauvinisme régional s’exprime d’autant plus que perdurent les particularités linguistiques (le français dans le val d’Aoste et l’allemand ou le ladin dans les Dolomites), ce qui renforce les identités régionales. Plusieurs communautés restent particulièrement attachées à leurs traditions. Par exemple les Walser, peuple d’origine germanique arrivé du nord, dans la vallée de Gressoney, il y a plus de huit siècles. La culture des Walser est encore bien visible dans leur architecture, leurs coutumes et leur langue. Leurs maisons sont bâties en bois et en pierre, sur un étage ou deux, avec de grands balcons et un toit très en saillie.
La famille : une valeur toujours très ancrée
L’influence de l’Eglise catholique romaine reste sensible sur la structure familiale. D’une manière générale, les liens familiaux sont plus forts en Italie que dans n’importe quel autre pays d’Europe occidentale. Néanmoins, les valeurs chères à l’Eglise se perdent. Le mariage reste le plus important accomplissement dans la vie des Italiens. La religion, en tant que valeur morale, a toujours beaucoup de poids dans la structure familiale mais n’est plus un obstacle quant aux décisions de séparation. De plus, en raison de difficultés souvent économiques, les Italiens se marient tard, ont des enfants plus tardivement encore et, fatalement, en ont peu. La morale chrétienne est reléguée au rang de valeurs de grand-mère pour la nouvelle génération. En effet, les jeunes consacrent beaucoup de temps à se retrouver entre amis et à paraître beaux, élégants lors de la passeggiata ou des sorties nocturnes et à faire la fête dans les dernières boîtes à la mode.
Le mammisme italien
Les caricatures ou autocritiques du cinéma d’après-guerre à propos de la fameuse mamma italienne sont toujours actuelles. C’est un véritable phénomène de société… On parle de « mammisme » en Italie pour désigner la proximité de la mamma italienne, la mère de famille, et de ses enfants. La mamma pour un Italien, c’est tutto, « tout », sa vie, son passé, son présent et son avenir. Sans sa mamma, un Italien semble déboussolé ! Les Italiens n’arrivent pas à couper le cordon ombilical et restent donc longtemps chez leurs parents. En effet, 42 % des Italiens vivent à moins d'une demi-heure de leurs parents et 30 % carrément chez eux. Plus les enfants quittent tard la maison parentale, plus les parents sont heureux. Le point de vue des enfants, encore aujourd’hui, n’est pas très clair. D’un côté, le luxe de se laisser couver n’est pas à négliger, tandis que de l’autre, le peu de ressources économiques retarde le départ du nid familial. Famille, destins, organisation domestique et parenté dans les Alpes italiennes sont de vastes questions.
Une natalité en berne
Comme dans tous les pays européens, le pays connaît un taux de natalité très bas. Il est de 7,45 ‰ pour un taux de mortalité de 10,70 ‰. Il est tiré vers le bas par un taux de fécondité, en constante baisse, de 1,35 enfant par femme, insuffisant pour le renouvellement des générations, d'où le risque à terme d'un dangereux vieillissement de la population. Cependant, ces données alarmistes ne reflètent pas les fortes disparités existant entre les régions : le Nord, dont les villes de Milan et Rome sont déficitaires en naissances, et le Sud, dont le solde naturel est resté excédentaire à Naples et à Palerme par exemple. Ces chiffres sont la traduction d'un véritable phénomène de société, d'un changement de mentalité, dû à l'urbanisation, à l'enrichissement ou encore à la baisse d'influence de l’Église, notamment chez les jeunes. La distribution sexuelle est assez homogène : 49 % d'hommes pour 51 % de femmes. L'espérance de vie est de 80 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes.
Des retraités très nombreux
Le problème des retraites, d'actualité en France, l'est aussi en Italie. Le chômage endémique, la population vieillissante et le taux de natalité en berne ne permettent pas de renouveler la population des actifs pour maintenir les cotisations retraites à un niveau suffisant. L’âge légal de départ, qui était 66 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes, a été fixé à 67 ans pour les hommes depuis 2019. Il sera alors nécessaire de cotiser 43 ans et 3 mois pour les hommes, et 42 ans et 3 mois pour les femmes. La Covid-19 a bouleversé néanmoins les statistiques, spécialement dans les Dolomites et la région alpine de l’Italie. Si le pays a enregistré près de 115 000 morts en avril 2021, beaucoup étaient des personnes âgées, principalement dans les régions Lombardie et Vénétie, les premiers foyers de l’épidémie.
Un système éducatif européen classique
En Italie, le taux d’alphabétisation est de 98 %. L’école publique est gratuite et obligatoire jusqu’à 16 ans. Les divisions scolaires se déroulent de la maternelle (de 3 à 5 ans) au primaire (à 10 ans), jusqu’à l’équivalent du collège français, appelé « intermédiaire » en Italie et sanctionné par un examen important de fin d’études (équivalent du BEPC en France). Ensuite, au lycée, les élèves peuvent choisir entre les études d’enseignement classique, scientifique, littéraire ou artistique. L’examen, la maturità, correspond au baccalauréat français.
Le système universitaire est partagé en deux cycles, de 5 ans au total, aligné sur le système « LMD » européen. Après les trois premières années est délivrée une laurea breve (qui correspond à une licence française), puis il faut faire encore 2 ans pour obtenir une laurea specialistica (un master).Un taux de chômage préoccupant
Les aléas de la crise européenne n'épargnent pas l'Italie. La situation économique serait comparable à celle de la France en Italie du Nord et à celle de l'Espagne en Italie du Sud. Le taux de chômage est préoccupant (10,8 % en 2019), ne faisant qu'accentuer les disparités Nord/Sud préexistantes...). Le chômage des jeunes reste élevé, à 39 % (2019). Nombreux sont les jeunes actifs à demeurer encore chez leurs parents ou à vouloir s'expatrier vers des destinations lointaines plus rentables.
La corruption : un problème endémique
L’Italie tente depuis 30 ans de se débarrasser d'un mal qui gangrène son pays : la corruption, aussi appelée la « culture de l'illégalité ». En 1992, Mani Pulite (mains propres), opération de grande envergure lancée par un groupe de juges milanais, entend combattre la corruption qui touche dans le milieu politique les plus hautes instances de l’Etat, et la mainmise de la mafia sur ceux-ci. Dès lors, un des juges du programme, Antonio di Pietro, met en cause plus de 150 politiciens. Cinquante ans de politique et de nombreux partis, en premier lieu la Démocratie chrétienne (DC) et le parti socialiste (PSI) de Bettino Craxi, périclitent après une série de scandales, corruptions, tangentopoli (de tangente, « pot-de-vin ») en une myriade de nouveaux petits partis changeant de noms, d’esprit et d’alliance.
Mais quel bilan aujourd’hui, près de 30 ans après l’opération Mani Pulite ? Selon l’ONG Transparency International qui dresse un classement de la perception de la corruption dans les administrations publiques et la classe politique de 180 pays, l’Italie, qui arrivait à la 72e place en 2012 (mouton noir européen), a progressé à la 51e place en 2019, grâce à l’adoption de la loi Severino en 2012 et l’institution d’une autorité nationale anti-corruption en 2014. La corruption gangrène toujours l’économie du pays, mais l'enrichissement personnel a fait place au financement des grands partis politiques, qui se chiffre désormais à environs 60 milliards d’euros pour la corruption et 120 milliards d'euros pour l'évasion fiscale. Les médias italiens en ont fait un marronnier permanent dans leurs Unes. On peut citer l'affaire Mafia Capitale à Rome, les travaux pour la digue Moïse à Venise, les appels d'offres truqués de l'Exposition universelle de Milan… En 2019, cinq des onze membres du Conseil supérieur de la Magistrature, la plus haute instance judiciaire italienne, ont dû démissionner, mouillés dans un gros scandale de corruption et de connivence entre hommes politiques et juges. La culture de l’illégalité a encore semble-t-il de beaux jours devant elle.La mafia toujours présente
Allant de pair avec la corruption, la mafia est aussi un problème italo-italien, même dans le nord du pays. La mafia est l’un des principaux enjeux auxquels doit faire face le pays. Certains étymologistes y voient son origine dans le mot toscan maffia, signifiant « misère », d’autres dans l’expression arabe Mu’afah qui se traduirait par « la protection des pauvres ». Les mafiosi étaient aussi des Robin des Bois qui volaient aux riches pour donner aux pauvres dans l’imagerie populaire. Associée dans les esprits au trafic de drogue et aux meurtres, au départ, le but de la mafia est pourtant noble : défendre les pauvres contre les injustices de la société féodale (toutes ces bonnes intentions ont bien évolué…). De cette époque, elle garde seulement des codes bien établis basés sur la famille (selon l’écrivain sicilien Leonardo Sciascia, la famille serait « la première racine de la mafia »), l’honneur et la loi du silence. Ce n’est qu’au fil du temps que la mafia s’est structurée en une véritable société secrète, avec l’implacable omertà (la loi du silence qui condamne à mort, avec une pierre dans la bouche, celui qui la transgresse), et une organisation multinationale à faire pâlir les scénaristes de James Bond. Par ses ramifications dans le monde social, économique et politique, elle est en Italie surnommée « la pieuvre ». Seules quelques figures, comme Salvatore Giuliano, qui n’est d’ailleurs pas considéré comme mafieux par ceux qui le défendent, ont rendu un temps service à l’image mafieuse par leur résistance à l’envahisseur durant la guerre.
Si elle est présente dans tout le pays, les principales branches de la mafia sont dans le sud : la Camorra à Naples, la N’Drangheta en Calabre, la Sacra Corona Unità dans les Pouilles et la Cosa Nostra aux Etats-Unis, appelée en Sicile l’Onorata Società. Aujourd’hui, la mafia est davantage financière que criminelle, et agit parallèlement à l’Etat. Chaque quartier, bourgade, ville est géré conjointement par l’Etat et la mafia. D’après certains experts, elle serait aujourd’hui la vingtième puissance financière au monde.