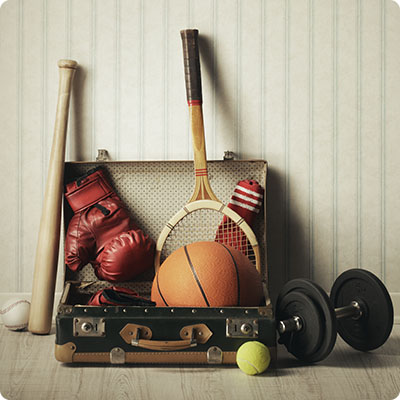De l'art roman au style Plantagenêt
Traversé par les grands prédicateurs chrétiens du haut Moyen Age – Hilaire, Martin, Jouin, etc. –, qui y fondent de puissantes abbayes, le Poitou, berceau de l'architecture religieuse romane, abrite près d'un millier de constructions. A commencer par le baptistère Saint-Jean (Poitiers), érigé à partir du IVe siècle, et l'église de Saint-Généroux, fondée autour de 900, l'une des plus anciennes de France.
L'art roman poitevin se distingue dès l'an mil pour ses solutions architecturales innovantes. Parmi elles, un système de nef centrale supportée par deux bas-côtés aux impressionnantes hauteurs ; un chœur-déambulatoire menant à des absidioles. Il connaît son âge d'or au XIIe siècle, souligné par un décor sculpté extrêmement riche, que l'on explique par la qualité du calcaire local et une école de taille minutieuse, parfaitement géométrique. Parmi les grands thèmes iconographiques reviennent végétation luxuriante, animaux fabuleux, combat des vices et des vertus, figure du cavalier et de sa monture. Ce dernier, dont on peine encore à comprendre la signification, vous l'observez dans toute sa splendeur à Saint-Hilaire de Melle, étape des chemins de Compostelle et inscrite à ce titre au patrimoine mondial de l'humanité. Estampillée elle aussi Unesco, l'abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe justifie à elle seule votre voyage : non seulement s'y déploie le plus vaste ensemble de fresques d'Europe, mais également un programme architectural grandiose. Arrêtez-vous à Poitiers contempler la façade historiée de Notre-Dame-la-Grande (Péché originel, Visitation, Nativité et scène apocryphe du Bain de l'enfant), les vitraux de Sainte-Radegonde et les chapiteaux de Saint-Hilaire-le-Grand.
Avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri Plantagenêt, en 1152, et jusqu'au XIVe siècle, se dessine une nouvelle spécificité : le style Plantagenêt (ou angevin, car largement diffusé en Anjou), variante gothique caractérisée par des voûtes bombées reposant sur huit nervures toriques rayonnantes, sensiblement inspirées du principe de la file de coupoles répandu alors en Aquitaine. Citons la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers (ses voûtes, son chevet plat et l'absence d'arcs-boutants), l'église abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes (voûtes remaniées au XIIIe siècle dans la plus pure expression du style), la collégiale Saint-Pierre d'Airvault.
Les Poitou-Aquitaine-Plantagenêt marqueront leur territoire d'autres constructions emblématiques : le palais ducal de Poitiers, dit le Palais, et sa salle des pas perdus aux arcatures aveugles et à la monumentale cheminée à trois foyers (spot « royal » où apprécier votre pique-nique, tables et chaises à disposition) ; le double donjon de Niort, bâti par Henri II Plantagenêt et Richard Cœur de Lion. Durement meurtrie par la guerre de Cent Ans (1337-1453) puis par les guerres de Religion (1562-1598), l'architecture religieuse poitevine retrouve un second souffle à la contre-réforme, en témoigne l'abbaye royale de Celles-sur-Belle fondée au XIIe siècle, détruite en 1568 puis reconstruite par François le Duc au XVIIe siècle.
Des forteresses médiévales aux châteaux d'apparat
Erigé en 778 par Charlemagne et organisé en un essaim de seigneuries, le comté de Poitou est dévasté par les invasions vikings au IXe siècle, peuples normands dont il subit l'influence, tout particulièrement en matière d'architecture défensive. Le château fort – entendez un abri fortifié répondant à trois fonctions, résidence, défense et symbolisme de pouvoir – y supplante la motte castrale dès l'an mil, par exemple à La-Tour-au-Cognon (Civaux). Ses incessantes améliorations en feront une arme redoutable, non pas contre d'éventuels envahisseurs barbares, mais partie prenante des révoltes seigneuriales entérinées avec le déploiement de l'empire Plantagenêt en Aquitaine (soldées par la bataille de Taillebourg, en 1242) et le conflit ayant opposé le Lys et le Lion jusqu'à l'achèvement de la guerre de Cent Ans (1453).
Parmi le millier de châteaux recensés entre Vienne et Deux-Sèvres, comptez une cinquantaine de forteresses dont la colossale Bressuire (enceinte de 700 mètres flanquée de 38 tours, ruines du logis seigneurial du XVe siècle), la moindre Airvault, ou encore Cherveux (grandiose par ses contreforts triangulaires, son donjon de 5 étages, son chemin de ronde et sa charpente). Chef-d'œuvre d'ingénierie et de sophistication, unique en Europe au regard de son état de conservation, le château fort de Coudray-Salbart (Echiré) se distingue. Dans cette impressionnante machine de guerre, qui pourtant ne prendra jamais les armes, se déploie toute une toile d'innovations architecturales et militaires : tours en amande, voûtes Plantagenêt, rarissime gaine périphérique intérieure, etc. Côté Vienne, vous découvrez la spectaculaire forteresse d'Angles-sur-l'Anglin, perchée à 40 mètres, ainsi que l'invincible Gençay, entièrement modernisé après 1242 à la faveur de son soutien à la couronne de France. Il terminera sa course dans les années 1820, transformé en carrière de pierres (d'où les jolies maisons alentour).
En 1367, l'ordonnance de Charles V réorganise le système défensif du royaume, obligeant petits et grands seigneurs à remettre leurs bastions en état de supporter un siège : la très photogénique forteresse de Saint-Mesmin (Saint-André-sur-Sèvres) en témoigne. De l'époque gothique, on retient également le château-maison forte d'Ebaupinay (Breuil-sous-Argenton), sauvé de la ruine en 2018 par une campagne internationale de crowdfunding.
Obsolètes, ruineux, passés de mode, les châteaux forts rendent les armes à la Renaissance pour laisser à de graciles et lumineux palais le loisir de se manifester, par exemple à Coulonges-sur-l'Autize (cuisines voûtées uniques en France). A partir de 1515, un étonnant spécimen aux airs de château de la Loire fleurit à Chef-Boutonne : le château de Javarzay, où vous attend depuis mars 2022 une nouvelle scénographie. Le style se manifestera dans toute sa splendeur au château d'Oiron (en marge de l'expo permanente d'art contemporain, l'exceptionnelle galerie de l'Ecuyer, décorée en 1572) et à Dissay (aujourd'hui luxueux hôtel-restaurant-spa). Ce palais grandiose, relooké par Lemercier à partir de 1638, fit causer en son temps : le château de Thouars, sa façade de 110 mètres de long, sa cour d'honneur et sa galerie en portique.
L'histoire des châteaux forts poitevins s'achève définitivement en 1626 avec la déclaration de Nantes : le cardinal de Richelieu exige en effet le démantèlement des fortifications et constructions non nécessaires à la sûreté de l'Etat…
De la hutte à la maison bourgeoise maraîchines
Le grand chantier d'assèchement de l'ancien golfe marin des Pictons démarre autour de l'an mil, donnant naissance, au fil des siècles, à variations d'environnements et à tout autant de modèles d'urbanisation. Arsenal de génie hydraulique et d'inventions qui permirent aux populations des terres hautes de conquérir les terres basses, sujettes aux caprices de l'eau. Au XVIIe siècle, avec l'apparition des premiers canaux, les huttiers conquièrent les zones inondables, leur hutte (cabane de bois et de roseaux) bordant les voies d'eau, posée à l'abri des crues sur une terrée (bande de terre étroite plantée de frênes et de saules) ou une motte (rehaussement artificiel consacré aux cultures). Ce modèle laissera place à la cabane, modeste habitation en moellons tout venant et pierre de taille, pensée pour accueillir une charpente à faible portée, généralement en peuplier. Ces fermes emblématiques à la jolie façade chaulée s'égrènent au fil des méandres du marais mouillé, parfois antérieures au XIXe siècle, intégrant sous le même toit logis, grenier-séchoir et balet, hangar partiellement ouvert reposant sur des piliers de pierre, fermé d'un bardage en peuplier.
En 1808, Napoléon Bonaparte entérine un décret d'aménagement de la Sèvre, grands travaux qui donneront à la Venise Verte son aspect d'aujourd'hui, féérique cathédrale de verdure. Autour des conches et des canaux l'habitat groupé émerge, à l'instar du village de plaine non inondable, ramassé autour de son église (Arçais, Coulon), et du village-rue dit linéaire. Ici, les maisons, mitoyennes et en enfilade, plus hautes que larges, forment un front bâti face à l'eau et à la rue (Saint-Hilaire-la-Palud, Sansais-La Garette). Vous n'aurez de cesse d'en contempler les pittoresques détails, inscription lapidaire, œil de bœuf, queue de bac (évacuation de l'évier), fenestron (ancien accès au grenier). A l'intérieur, le couloir et l'escalier menant aux greniers transformés en chambres à coucher n'apparaissent qu'après 1850 avec la modernisation des pratiques agricoles. En retrait, recluse derrière son muret et sa grille d'entrée la laissant entrevoir, la maison bourgeoise en pierre de taille discrètement se pavane. Son imposant volume la distingue de même que sa façade ordonnancée, un toit à quatre pans de tuiles ou d'ardoise, ses corniches, bandeaux, chaînages et autres signes distinctifs du rang social de ses propriétaires.
Vous découvrez en Marais poitevin d'autres environnements, d'autres paysages et d'autres formes d'habitat. Par exemple la maison rurale de pêcheur, typique des littoraux charentais et vendéens, sinon la cabane basse, semblable à la bourrine vendéenne, caractéristique du marais desséché et des anciennes îles calcaires, émergences inhérentes à la disparition de l'eau.
Ce patrimoine maraîchin, à l'instar de la faune et de la flore, fait aujourd'hui l'objet d'une protection rapprochée. Il fut considérablement valorisé par les Grands Travaux (lancés en 1992 par François Mitterrand et Ségolène Royal), destinés à sauvegarder infrastructures hydrauliques (ponts, écluses, barrages), urbaines (canaux, ports et quais, villages) et architecture (habitations, lieux-sources, comme les lavoirs). Depuis, tout projet de construction ou de rénovation est extrêmement réglementé.