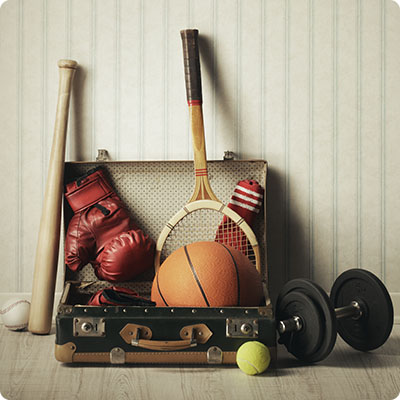Mélusine, à Lusignan
C'est l'histoire d'une malédiction, d'un serment brisé et d'un amour perdu, la love story de Mélusine et de Raymondin qui tourna bien tristement au vinaigre. En la forêt giboyeuse de Coulombiers leurs regards se sont croisés, instant magique auprès de la fontaine de la Soif (lieu-dit Font-de-Cé, à Lusignan). Son éblouissante beauté l'en fit tomber éperdument amoureux ; il l'épousa pratiquement sur-le-champ, jurant de la laisser se retirer chaque samedi et de ne jamais, ô grand jamais, chercher à la retrouver en ce jour. De leurs amours naquirent, outre beaucoup d'enfants, l'impérieuse forteresse de Lusignan (avérée comme l'une des plus vastes de France, démantelée en 1586), une puissante maison auréolée de gloire. Toutes ces années Mélusine tira profit de son bien dissimulé secret, lourde punition infligée par sa mère pour l'éternité. A l'insu de son époux, elle déployait ses ailes la nuit venue, survolait le Poitou pour s'activer à l'ouvrage, transporter tonnes de pierres dans sa dorne et bâtir cités, églises et forteresses grandioses en nom des Lusignan. Ainsi apparut la Pierre-Levée, blocs que la fée laissa échapper au-dessus de Poitiers (magnifique dolmen du néolithique, dissimulé dans le quartier de Montbernage). Jusqu'à ce qu'ardente jalousie conduise Raymondin à braver l'interdit, pousser la porte de sa bien-aimée et découvrir son diabolique appendice, une queue de serpent – c'est d'ailleurs pour la baigner que Mélusine fit jaillir de l'eau au creux de sept chênes en la forêt de Chizé (la baignoire de Mélusine, monument naturel à ne pas manquer). Le tragique trépas d'un de leurs illustres fils, brûlé vif par son aîné, les mena à leur perte : Raymondin, fou de chagrin, accusa Mélusine en public. Evanouie, l'infâme serpente revint à elle en annonçant l'inéluctable ruine des Lusignan, ouvrit ses ailes, s'éleva dans le ciel, vola trois fois autour de la citadelle en poussant des cris stridents puis disparut à jamais. On dit aujourd'hui en pays Mélusin que la fée réapparaît lorsque l'un de ses descendants se meurt...
Si l'Histoire fait mention d'une légendaire créature féminine hybride en Poitou, Mélusine doit son extrême popularité au libraire-éditeur Jean d'Arras. En 1392, Jean de Berry, comte de Poitou, commande à l'homme de lettres une chronique généalogique épique consacrée aux Lusignan. Celle-ci, grâce à l'imprimerie, est à considérer comme l'un des grands best-sellers de son époque : Mélusine ou la noble histoire de Lusignan. L'œuvre en prose, très largement diffusée, s'inscrit dans la lignée des romans dynastiques du bas Moyen Age faisant de la fée, outre le mythe fondateur de la maison, une héroïne mi-femme, mi-démon connue par monts et par vaux.
Les Lusignan régneront du Xe au XIVe siècle, seigneurs de leurs fiefs, Lusignan et Couhé, parvenus à mettre la main sur les comtés de la Marche et d'Angoulême, par ailleurs illustres croisés devenus princes de Chypre et rois de Jérusalem. La roue tournera avec Hughes X de Lusignan, héritier de longues années de mécontentements (avec le mariage Aliénor-Plantagenêt, en 1152, les seigneurs du Poitou perdront beaucoup de leur autonomie et organiseront plusieurs coalitions contre leurs suzerains), allié aux Plantagenêt. Venu insulter Alphonse de Poitiers – comte de Poitou, prince de sang royal et frère de Louis IX (Saint Louis), en son palais, il subira l'année suivante une violente contre-offensive royale à Taillebourg, ou l'écrasante victoire du royaume capétien contre le blocus Lusignan-Plantagenêt. La ruine de la maison est enclenchée, dépossédée de près d'un tiers de ses biens... On précise que la bataille de Taillebourg compte parmi les innombrables événements qui déclencheront la guerre de Cent Ans (1337-1453).
Organisez-vous un circuit-découverte des plus beaux ouvrages de Mélusine, dispatchés entre Vienne et Deux-Sèvres : la ville de Lusignan, bien sûr, où vous admirez quelques restes de la noble forteresse, le Coudray-Salbart, innovant château fort érigé durant la guerre de Cent Ans (ne vous y aventurez jamais la nuit, sous peine d'y capter d'énigmatiques hurlements), les châteaux de Cherveux et de Parthenay, le donjon et la flèche de Notre-Dame de Niort inachevée (Mélusine, surprise en plein travail, aurait abandonné son chantier toute affaire cessante en oubliant d'y poser la dernière fenêtre, l'incident se répétera ailleurs, par exemple à Celles-sur-Belles, à Verruyes et à Ménigoute).
La Grand'Goule, à Poitiers
La pieuse et charitable Radegonde (519-587), épouse rebelle de Clotaire Ier et reine des Francs, fuit la cour de Soissons pour s'établir à Poitiers. Elle y fonde le monastère Notre-Dame autour de 550, devenu Sainte-Croix en 567 lorsqu'il accueille les reliques de la sainte Croix (bâtie à l'emplacement de l'actuel musée éponyme, l'abbaye fut transférée, avec ses trésors, en la commune de Saint-Benoît). Radegonde, sainte patronne de Poitiers, possède sa légende dorée : on dit qu'elle s'illustra contre la sanguinaire et invincible créature qui, sortie de sa tanière de la vallée du Clain, s'aventura à travers souterrains jusque dans les caves du monastère en quête de quelques religieuses à croquer. Ni les suppliques ni les prières ne purent mettre fin au carnage, la Bête continua de sévir. Si bien que Radegonde s'enquit de l'affronter, pourchassa le dragon, lui assenant salves de signes de croix et de malédictions. La créature mourut dans d'atroces souffrances.
Cette Grand'Goule, personnification locale du combat du bien contre le mal, assura la protection de Poitiers jusqu'au XIXe siècle. Elle fut associée à la procession des Rogations (les trois jours précédant le jeudi de l'Ascension, inspirée des rituels païens en faveur des récoltes et des moissons), d'abord peinte sur une bannière puis, à partir de 1677, sous la forme d'une effigie articulée, œuvre en bois polychrome du maître-sculpteur Jean Gargot. A son passage, on jetait gâteaux, oublies, casse-museaux en criant la formule suivante : « Bonne sainte vermine, priez pour nous. » Le culte disparaît complètement avec la modernisation des pratiques agricoles ; quant au monstre de 57 cm de hauteur, il fut redécouvert par hasard dans les réserves du grand séminaire de Poitiers. Vous l'admirez au musée Sainte-Croix, gueule béante tous crocs dehors.
Lointain souvenir, la Grand'Goule peine pourtant à quitter la mémoire collective des Poitevins. Elle prêtera son nom à une revue consacrée aux arts et au patrimoine éditée de 1929 à 1944 (en accès libre sur Gallica, site de la BNF ; https://gallica.bnf.fr), et, surtout, à la mythique boîte de nuit du centre-ville inaugurée en 1965 (un passage obligé ! www.lagoule.fr). Il suffira de marcher quelques pas pour découvrir, elle aussi nichée aux pieds de la cathédrale Saint-Pierre, l'église romane Sainte-Radegonde, largement remaniée au XIIIe siècle dans le plus pur style Plantagenêt. Ce chef-d'œuvre à nef unique abrite non seulement le sarcophage et les restes de la sainte, mais également une exceptionnelle suite de vitraux (dont une verrière datée de 1270). Vous verrez, l'atmosphère y est captivante. Dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville de Poitiers, les passionnés jetteront un œil à ce tableau de Pierre Puvis de Chavanne, Sainte Radegonde écoutant une lecture du poète Fortunat.
Le(s) dragon(s) de Niort
Impossible de les ignorer, les quatre dragons en bronze de Niort, œuvres de l'architecte-plasticien Jacques Hondelatte, installés rue Aimable-Ricard en 1992, déboulonnés en 2011, puis réintégrés l'année suivante. Eux aussi emblématiques, ils encadrent le centre piétonnier de Niort racontant cette fameuse légende du soldat et du dragon, apparue au XVIIe siècle.
Il était une fois un gigantesque serpent ailé qui sévissait autant dans les eaux saumâtres du Marais mouillé que sur la terre ferme, tenant repaire dans un souterrain de la rue Saint-Jean. Au jeune et déserteur soldat Allonneau, condamné à mort, l'on promit la grâce s'il parvenait à débarrasser le pays et son peuple, terrifié, de sa Bête sanguinaire. Paré de son armure et de son glaive, il s'acharna avec agilité à la tâche, jusqu'à transpercer la gorge du monstre. Le crédule malheureux, croyant sa cible terrassée, ôta le casque de verre qui l'en protégeait du venin : le dragon l'empoisonna dans un ultime souffle et l'entraîna dans sa perte.
Cette légende fait écho aux dragonnades, persécutions menées à l'encontre des Huguenots afin de pousser les plus récalcitrants à se convertir. C'est l'intendant du Poitou, René de Marillac (1638-1719), qui les met au point en 1681, sommant les réformés à loger et à satisfaire chacune des rigoureuses exigences des dragons, soldats de l'armée régulière. Le procédé fut déployé partout dans le royaume jusqu'en 1686, et même réitéré au XVIIIe siècle (la dragonnade de Mayenne, en 1758, est l'une des plus répressives). La pluie de critiques émise par l'Europe entière poussa Colbert à les interdire et à destituer Marillac. La mort du contrôleur général des finances, en 1683, enterrera ces mesures.
C'est un détail, mais il mérite que l'on s'y attarde : la légende du soldat et du dragon rappelle étrangement cette variante de l'histoire de la Grand'Goule, qui attribue le terrassement de la Bête non pas à Radegonde mais à un condamné à mort sorti du combat indemne pour les uns, empoisonné, pour les autres, après avoir ôté son heaume de verre et respiré l'haleine fétide de la créature... Et ce n'est pas tout ! Le dragon, personnification locale du mal, pourrait bien n'être ni plus ni moins qu'un crocodile. En effet, plusieurs spécimens empaillés avaient été introduits en Poitou, l'un, comme en témoigneront de très nombreux voyageurs, exposé dans la grande salle du palais ducal de Poitiers abandonnée aux marchands et aux curieux, l'autre, comme vous pourrez le voir, en la collégiale Saint-Maurice d'Oiron. Ce dernier reptile, concédé à un souvenir de voyage de l'amiral Gouffier de Bonnivet (XVIe siècle) est aussi communément associé à une très ancienne légende, le combat de saints Jouin et Hilaire, célèbres prédicateurs chrétiens du Poitou, contre le dragon des marais de la Dive...