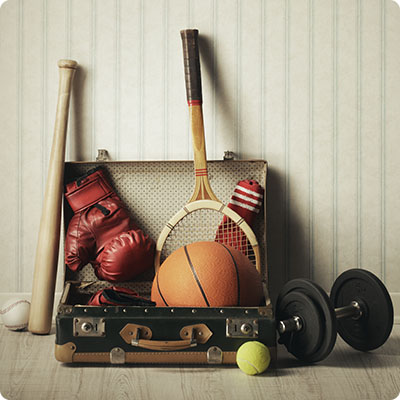Bahreïn, terre d’islam
Bahreïn, terre d'islam : officiellement, 99,8 % des citoyens bahreïnis sont musulmans. Mais si l'on tient compte de l'ensemble de la population qui vit dans l'archipel – largement composée de travailleurs immigrés – cette proportion tombe à environ 70 %. Parmi les Bahreïnis de souche, entre 70 et 75 % se réclament du chiisme, courant de l'islam qui reconnaît le gendre du Prophète, Ali, comme son véritable successeur. Ils suivent les enseignements des ayatollahs, disposent de leurs propres fêtes religieuses et traditions, parfois bien différentes de celles du sunnisme.
Cette majorité chiite s'explique par l'histoire de l'archipel, longtemps sous domination perse aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Elle cohabite avec une élite sunnite, issue des tribus venues de la péninsule arabique. La famille régnante des Al-Khalifa, qui gouverne Bahreïn depuis 1783, est sunnite. Cette différence confessionnelle entre une grande partie de la population et ses dirigeants politiques et militaires alimente régulièrement tensions et frustrations. Elle fut l'un des facteurs déclencheurs du soulèvement de 2011.
Sunnisme et wahhabisme
Si les Al-Khalifa sont sunnites, certains observateurs les associent aussi au wahhabisme, courant rigoriste fondé au XVIIIe siècle par le prédicateur Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Rejetant toute innovation étrangère au Coran et à la sunna, cette école de l'islam, souvent considérée comme radicale, interdit l'invocation des saints et refuse toute représentation religieuse. Selon cette doctrine, pour être un bon musulman, il faudrait vivre comme au temps du prophète. Le wahhabisme a longtemps été lié à l'Arabie Saoudite, à travers une alliance entre le pouvoir politique des Saoud et les autorités religieuses.
À Bahreïn, les mosquées obéissent à une architecture sobre. Elles sont toujours orientées vers La Mecque, avec un mihrab – niche murale indiquant la direction de La Mecque –, un minaret d'où le muezzin appelle à la prière cinq fois par jour, et un minbar (chaire) où l'imam prononce ses sermons. Les ablutions sont obligatoires avant de prier : les fidèles se lavent les mains, le visage et les pieds dans un point d'eau prévu à cet effet, en général juste à l'extérieur de la mosquée.
Les cinq piliers de l’islam
La pratique de l'islam s'articule autour de cinq piliers : la profession de foi (chahada), la prière rituelle (salat), l'aumône légale (zakat), le jeûne du mois de ramadan (sawm), et le pèlerinage à La Mecque (hajj). À Bahreïn, la prière est omniprésente dans la vie quotidienne : à la maison, dans les mosquées, mais aussi dans les centres commerciaux ou les aéroports, qui disposent de salles spécifiques pour ne pas rater une des cinq prières quotidiennes. Le ramadan est une période centrale dans la vie religieuse et sociale. Pendant un mois, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil. À la tombée de la nuit, le jeûne est rompu autour de plats traditionnels, en famille ou entre amis. Les horaires de travail sont alors aménagés, et tout le pays vit surtout la nuit. La fête de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du ramadan, est une des plus grandes fêtes de Bahreïn : on offre parfois des cadeaux et des repas gargantuesques sont organisés.
Autre fête importante, l'Achoura chiite, qui commémore le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète. À cette occasion, des processions sont organisées, et les croyants revêtent des habits noirs en signe de deuil. Ces célébrations, très visibles dans les quartiers chiites de Manama ou de Muharraq, rappellent que l'islam bahreïni est profondément pluriel.
Une liberté religieuse préservée
Bahreïn garantit officiellement la liberté de culte. Une pluralité religieuse permise par la présence massive de travailleurs immigrés venus du sous-continent indien, des Philippines ou encore d'Afrique de l'Est. Dans les rues de Manama, on trouve des temples hindous, des gurdwaras sikhs, des églises chrétiennes de toutes confessions, et même une synagogue.
Les chrétiens représenteraient environ 14 % de la population résidente, majoritairement originaires des Philippines. Mais une petite communauté de chrétiens arabes vit dans l'archipel depuis des générations – près d'un millier de personnes, rattachées à l'Église d'Orient. La première mission chrétienne européenne remonte quant à elle à 1896. Depuis, plusieurs églises ont été construites, comme la Sacred Heart Church, fondée en 1939 pour les catholiques, ou la cathédrale anglicane Saint Christopher. Des messes y sont célébrées quotidiennement, dans plusieurs langues, notamment en anglais, en tagalog, en hindi – et même parfois en français.
Les hindous disposent de plusieurs lieux de culte, dont l'ancien temple Krishna de Manama, situé en plein centre-ville. Diwali, la fête des lumières, y est célébrée chaque automne. De même, les vitrines des centres commerciaux se parent de décorations de Noël dès le mois de décembre, même si la fête n'est pas officiellement reconnue.
La plus ancienne communauté juive du Golfe
Bahreïn se distingue aussi par la présence de la seule communauté juive encore active dans les monarchies du Golfe. Installés au XIXᵉ siècle, ces juifs irakiens ont connu des périodes de tension – notamment après la Seconde Guerre mondiale – mais ont toujours conservé leur synagogue à Manama. Aujourd'hui réduite à une poignée de familles, la communauté bénéficie d'une totale liberté de culte et entretient des liens étroits avec la monarchie. Une de ses représentantes, Houda Nonoo, a même été nommée ambassadrice de Bahreïn aux États-Unis entre 2008 et 2013, devenant ainsi la première femme juive ambassadrice d'un pays arabe.
Un islam ancré dans la société
À Bahreïn, la religion structure profondément la vie quotidienne. L'État soutient de nombreuses œuvres caritatives à travers le Zakat and Charity Fund, qui collecte les dons volontaires pour les redistribuer aux plus démunis. Cette forme d'impôt religieux reste très respectée par les Bahreïnis, toutes confessions confondues. Dans un royaume où les tensions confessionnelles ne sont jamais très loin, la religion est à la fois un marqueur identitaire, un facteur de stabilité… et parfois la cause de fractures profondes dans la société.