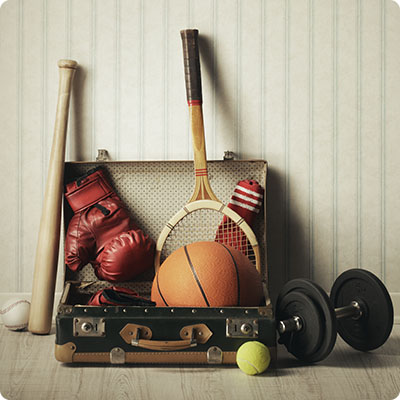Une population éduquée
Bahreïn a été le premier pays du Golfe à instaurer un système éducatif public. Dès 1919, deux écoles élémentaires pour garçons ouvrent leurs portes, suivies dès l'année suivante par un établissement destiné aux jeunes filles — une révolution dans la région. Aujourd'hui encore, l'enseignement primaire et secondaire y est gratuit, tandis que l'université publique est soutenue par un généreux système de bourses. Le pays affiche un taux d'alphabétisation élevé, fruit d'une tradition ancienne : l'archipel fut jadis un centre d'études islamiques rayonnant au Moyen Âge. Mais ce système coexiste avec de nombreuses écoles privées, souvent prisées par les familles aisées, qui n'hésitent pas à envoyer leurs enfants à Londres, Bombay ou Beyrouth. L'université de Bahreïn, fondée en 1968, forme aujourd'hui une jeunesse ambitieuse et de plus en plus présente dans tous les secteurs de la société.
Le rôle singulier des femmes
Dans la péninsule arabique, le statut des femmes bahreïnies fait figure d'exception. Elles peuvent conduire, voyager seules, ouvrir un compte en banque sans autorisation masculine – autant de libertés parfois interdites dans certains pays voisins. Depuis 2002, elles disposent du droit de vote et se présentent aux élections. Si certaines optent pour une tenue occidentale, beaucoup portent encore la jehaba, une longue robe traditionnelle souvent brodée d'or ou d'argent. Le voile est facultatif, le niqab plus rare, souvent porté par des touristes saoudiennes. Dans les rues de Manama, on croise souvent des femmes élégamment habillées de marques françaises ou italiennes. Toutefois, malgré leur haut niveau d'éducation, les femmes sont encore majoritairement cantonnées à la fonction publique. Quelques-unes brisent le plafond de verre, comme Mai Al Khalifa, ex-ministre de la Culture, qui a impulsé une vaste politique de valorisation du patrimoine, toujours sans apparaître voilée en public.
Le mariage, pilier social
À Bahreïn, le mariage reste une affaire sérieuse, souvent pensée comme une alliance entre deux familles avant d'être une union sentimentale. Si les mariages arrangés deviennent moins fréquents, les relations amoureuses sans l'approbation des parents restent mal vues. Les fiançailles donnent lieu à des négociations autour de la dot, traditionnellement versée en or ou en bijoux. Lors des célébrations, les hommes et les femmes sont séparés, et les époux ne se retrouvent qu'à la fin. Ces fêtes peuvent rassembler jusqu'à un millier d'invités et s'étendre sur plusieurs jours. Mais là encore, les usages évoluent : les jeunes couples revendiquent plus de liberté, les unions d'amour se banalisent, et les cérémonies s'internationalisent.
Une société cosmopolite
Depuis l'Antiquité, Bahreïn accueille des voyageurs et commerçants venus du monde entier. Marchands indiens, colons portugais, puis expatriés occidentaux ont façonné une société ouverte, fière de sa tolérance. À la différence d'autres pays du Golfe, les Bahreïnis ne vivent pas tous dans des quartiers fermés et travaillent dans tous les secteurs, du taxi à la restauration. La cohabitation avec les communautés étrangères, venues notamment du sous-continent indien ou des Philippines, est généralement harmonieuse. La langue anglaise est couramment parlée, notamment dans les affaires et l'enseignement supérieur.
La diversité culturelle se reflète aussi dans les pratiques culinaires : à Manama, on trouve aussi bien des restaurants indiens, philippins, thaïlandais ou libanais que des enseignes occidentales. Les Bahreïnis aiment sortir en famille ou entre amis, et les centres commerciaux font souvent office de lieux de promenade autant que de consommation. Le week-end, de nombreuses familles s'y retrouvent pour partager un repas, faire du shopping ou simplement profiter de la climatisation dans un pays où les températures frôlent les 45 degrés en été. Les cafés à la mode, les chichas lounge et les chaînes internationales comme Starbucks côtoient les cafés traditionnels où l'on boit du thé au lait ou du café à la cardamome. Cette cohabitation entre ancien et nouveau est à l'image de la société bahreïnienne : ancrée dans ses traditions mais curieuse du monde.
Les codes de la politesse
La convivialité est une vertu cardinale à Bahreïn. Mais elle obéit à des règles précises. Lorsqu'un homme rencontre une femme, il doit attendre qu'elle tende la main. À défaut, il peut poser la main sur sa poitrine en signe de respect. Les salutations entre hommes proches se font par une bise sur les joues. Si vous êtes invité chez quelqu'un, retirez vos chaussures en entrant, croisez vos jambes sans pointer vos pieds vers la table, et mangez de la main droite. Accepter tout ce qu'on vous offre est de rigueur, quitte à laisser un peu dans votre assiette en guise de politesse. Apportez un petit cadeau, comme des chocolats, mais jamais d'alcool. Et sachez que l'invité d'honneur se voit souvent servir les morceaux les plus nobles… comme la tête du mouton.
Entre traditions et ouverture
La vie sociale bahreïnienne, structurée par les valeurs islamiques, n'en reste pas moins en constante mutation. Les fêtes religieuses comme l'Aïd ou l'Achoura sont célébrées dans un esprit de communauté, mais aussi de pluralisme. La présence d'églises, de temples hindous et même d'une synagogue témoigne d'une relative tolérance culturelle. Les nouvelles générations, connectées et diplômées, redéfinissent peu à peu les contours des mœurs traditionnelles. Ainsi, Bahreïn avance en équilibre : entre fidélité à ses racines culturelles et ouverture au monde, entre héritage tribal et aspiration à plus d'individualisme.
La jeunesse joue un rôle moteur dans cette évolution. Très connectée, elle s'exprime librement sur les réseaux sociaux, discute politique, religion ou genre avec une audace impensable il y a vingt ans. YouTubeurs, artistes, influenceuses lifestyle ou militantes féministes trouvent leur public à Bahreïn, parfois même au sein de la diaspora. Bien que les autorités surveillent les contenus critiques, une certaine liberté de ton subsiste, surtout sur les sujets de société. Les débats sur le droit des femmes, l'éducation sexuelle, ou encore l'environnement montrent qu'un changement culturel est à l'œuvre.
Enfin, la société bahreïnienne reste structurée autour de la tribu et du lien communautaire. Si les liens familiaux y sont très forts, les rapports intergénérationnels évoluent. Les jeunes revendiquent davantage d'autonomie, tout en respectant leurs aînés. L'individualisme progresse, sans pour autant faire éclater les solidarités traditionnelles. Le vendredi, jour de repos hebdomadaire, reste consacré aux repas familiaux, aux visites aux parents et aux retrouvailles communautaires. Bahreïn conjugue ainsi modernité, respect des anciens et ouverture sur le monde.