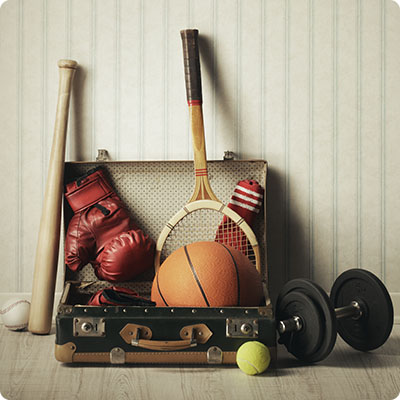Bahreïn, terre des Bahreïnis
Aujourd'hui, les villes arabes du Golfe persique sont une véritable vitrine de la société mondialisée propre au XXIe siècle : toute la planète s'y est donné rendez-vous, attirée par les lumières du capitalisme. Mais contrairement à ses voisins émiratis, Bahreïn a su garder une forte population locale : plus de 45 % de la population est d'origine bahreïnie, alors qu'à Dubaï ou au Qatar, plus de 87 % des habitants sont étrangers. Une véritable anomalie dans la région, qui s'explique par plusieurs facteurs.
Une préférence nationale
Le Royaume de Bahreïn a longtemps été plus peuplé que ses voisins du Golfe et, par conséquent, avait moins besoin de main-d'œuvre étrangère quand, au XXe siècle, cette partie du monde s'est développée à grande vitesse grâce à la manne financière des hydrocarbures. Alors, l'État bahreïni a cherché à favoriser ses propres citoyens. La loi oblige par exemple qu'au moins la moitié des employés d'une entreprise soient d'origine bahreïnie. Une préférence nationale qui aujourd'hui porte ses fruits. Alors qu'à Dubaï, un touriste ne croisera probablement jamais un Émirati, sur l'archipel, les Bahreïnis sont partout. Plus nombreux qu'aux Émirats, ils touchent moins de subsides de l'État et n'ont donc pas les mêmes opportunités économiques. Ils exercent des métiers que leurs voisins ont abandonnés depuis longtemps, comme chauffeur de taxi, serveur ou pêcheur.
Avec un peu plus de 1,5 million d'habitants, Bahreïn est l'un des plus petits pays du monde arabe en superficie, mais sa densité de population est l'une des plus élevées de la région. Près de 90 % des habitants vivent dans des zones urbaines, principalement dans la capitale et dans les villes avoisinantes, situées sur l'île principale de l'archipel. Cette concentration urbaine renforce les contrastes entre communautés et accentue les dynamiques sociales déjà complexes.
Une société arabo-perse complexe
Mais il ne faut pas s'y laisser tromper, la population elle-même est plus variée qu'on ne pourrait le croire. 70 % des Bahreïnis sont chiites, et eux-mêmes se divisent en deux groupes ethniques distincts. Les Baharnas d'abord, qui représentent la majorité des chiites de Bahreïn, et sont les héritiers de l'histoire antique du pays. Sémites, ils ont embrassé le chiisme au XVIIe et XVIIIe siècle. Les Ajam sont quant à eux les descendants d'immigrés perses arrivés au Bahreïn au XIXe siècle. Peuple de commerçants et d'artisans, ils ont su préserver leurs traditions et leur langue, le persan, qu'ils pratiquent dans l'intimité de leur foyer. Les sunnites, qui représentent 30 % des musulmans de l'archipel, sont originaires de la péninsule arabique et ont suivi l'émir Al-Fatih lors de sa conquête de l'île en 1783. Ces bédouins du désert descendent des tribus qui peuplaient la côte est de l'Arabie Saoudite et qui vivaient de l'élevage, de la pêche, du commerce et des nombreux raids qu'ils menaient contre les caravanes. L'organisation sociale de ces peuples-là, divisés et subdivisés en clans et tribus, est encore présente aujourd'hui. Le pouvoir royal héréditaire est par conséquent inséparable du tissu social et économique du royaume, au point qu'il est quasiment impossible de dissocier la famille régnante et l'État. Mais les bédouins ne sont pas les seuls Arabes sunnites de Bahreïn. Il ne faut pas les confondre avec les afro-arabes qui ont immigré à Bahreïn depuis la Corne de l'Afrique, ni avec les ouwalas, des sunnites iraniens qui ont quitté leur terre natale au XIXe siècle pour travailler à Bahreïn. Un mélange ethnique et religieux qui vit depuis des siècles en relative bonne entente.
Langues et identités multiples
Cette mosaïque de cultures et de peuples se reflète dans la diversité linguistique du royaume. L'arabe est la langue officielle et la plus couramment utilisée dans la sphère publique. Il s'agit d'un arabe dialectal, propre à la région du Golfe persique, qui ne sera pas forcément compris par quelqu'un originaire du Levant ou du Maghreb. L'arabe littéraire est quant à lui la langue du Coran. Mais plusieurs autres langues résonnent dans les rues de Manama. L'anglais, langue d'enseignement et de commerce, est omniprésente dans les entreprises, les administrations et les écoles privées. La plupart des Bahreïnis parlent d'ailleurs anglais, du moins suffisamment pour se faire comprendre. Le persan est encore parlé au sein des communautés ajam, bien que son usage soit de moins en moins courant. Mais dans les rues de Manama, principalement dans la vieille ville, les visiteurs entendront surtout des langues originaires du sous-continent indien, principalement le malayalam, le tamoul, l'hindi ou encore l'ourdou. Une pluralité linguistique qui est à l'image du pays : un archipel où coexistent traditions locales et influences étrangères.
Un brassage religieux et ethnique
Au cours des deux siècles précédents, les échanges commerciaux ont attiré dans l'archipel des grandes communautés indiennes et persanes, ce qui explique la forte population de travailleurs immigrés. Le développement fulgurant de Manama s'accompagne d'un besoin grandissant de main-d'œuvre et attire parallèlement un grand nombre de capitaux et d'investisseurs, séduits par le potentiel du royaume. Les étrangers ne bénéficient pas des mêmes lois que la population native. Ce statu quo explique la relative fracture sociale qui existe entre les locaux et les étrangers. La grande majorité des étrangers vivant à Bahreïn provient du sous-continent indien, c'est-à-dire du Pakistan, de l'Inde, du Népal, du Sri Lanka et du Bangladesh. Les autres communautés importantes sont les Philippins et les Égyptiens. Cette main-d'œuvre étrangère bon marché permet de faire tourner l'économie de l'archipel : ils occupent en général des emplois peu qualifiés dans les hôtels et les restaurants. Quant aux expatriés occidentaux, principalement européens et américains, ils travaillent principalement dans des secteurs clés comme les hydrocarbures ou les services bancaires. Bahreïn abrite également la seule communauté juive du Golfe. Jouissant d'une totale liberté de culte, ses membres cohabitent en parfaite harmonie avec leurs compatriotes musulmans, malgré quelques tumultes après la Seconde Guerre mondiale. L'une d'entre elles, Houda Nonoo, est même devenue députée à la Chambre haute.