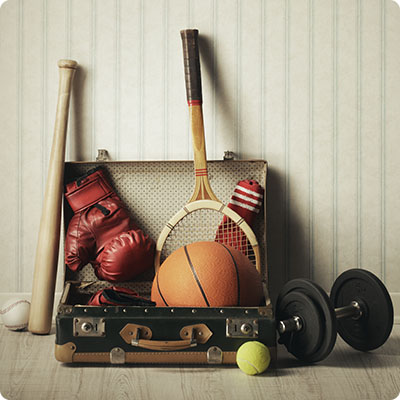Une monarchie toute puissante
Situé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, Bahreïn est le plus petit des pays du Golfe. Sa dynastie, les Al Khalifa, issue des tribus sunnites venues du Koweït, règne sans partage depuis 1783. Si la Constitution adoptée en 2002 a introduit un Parlement bicaméral et des élections législatives au suffrage universel, les leviers essentiels du pouvoir restent détenus par la famille royale. Le roi Hamad bin Isa Al Khalifa nomme les membres du Conseil consultatif, contrôle l'armée et désigne les principaux ministres. Le prince héritier, Salman bin Hamad, cumule les fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense et vice-commandant suprême des forces armées.
Cette concentration du pouvoir a longtemps alimenté la frustration d'une grande partie de la population, majoritairement chiite, exclue des postes décisionnels. Les élections de 2002 ont certes marqué une avancée symbolique avec la nomination de six femmes, dont une chrétienne, au Conseil consultatif, et une participation électorale relativement importante. Mais depuis, les espoirs de réforme démocratique ont été déçus.
La révolte de la Perle
En février 2011, dans le sillage du Printemps arabe, des milliers de Bahreïnis descendent dans la rue pour exiger des réformes politiques, la fin des discriminations et une monarchie parlementaire réelle. Le point de ralliement est la place de la Perle, à Manama, rapidement devenue le quartier général du mouvement. Le soulèvement est majoritairement porté par des chiites, mais des sunnites y participent également, dans un esprit d'unité nationale.
La réponse du régime est brutale : déploiement de l'armée, arrestations massives, torture, et démolition de la place de la Perle, devenue symbole de contestation. Appuyée par les troupes du Conseil de coopération du Golfe, notamment saoudiennes, la monarchie materne la révolte. Le mouvement est écrasé, au prix de dizaines de morts et de centaines de blessés.
Face aux critiques internationales, le roi lance une commission d'enquête indépendante, présidée par un juriste égyptien. Ses conclusions, publiées en novembre 2011, reconnaissent des exactions systématiques. Le gouvernement promet alors des réformes : augmentation du salaire minimum, contrôle parlementaire sur la nomination du gouvernement, et encadrement des services de sécurité. Mais dans les faits, peu de ces recommandations sont appliquées.
Une opposition muselée
Depuis 2011, la scène politique bahreïnie s'est largement refermée. Les partis sont interdits et remplacés par des « associations politiques », privées de véritables prérogatives. Les principales formations d'opposition, notamment Al-Wefaq (chiite) et Waad (laïque), ont été dissoutes par la justice. Plusieurs figures de la contestation ont été emprisonnées, comme le militant des droits humains Nabeel Rajab, condamné à de multiples reprises pour « propagande » ou « insulte aux institutions ».
Les élections législatives de 2014 et 2018 ont été boycottées par l'opposition, dans un climat de défiance généralisée. Les candidats indépendants, souvent proches du pouvoir, ont remporté la majorité des sièges. Quant aux médias, ils sont étroitement surveillés, et le journal d'opposition Al-Wasat a été suspendu en 2017. Le recours aux réseaux sociaux est également scruté : plusieurs internautes ont été condamnés pour des tweets critiques du gouvernement.
Une économie en reconversion
Longtemps dépendant de ses modestes réserves pétrolières, Bahreïn a été le premier pays du Golfe à comprendre la nécessité de diversifier son économie. Le secteur pétrolier, qui représentait encore 43 % du PIB en 2010, en génère aujourd'hui moins de 20 %. Pour compenser, Manama mise sur les services, la finance islamique, les technologies et le tourisme.
Le centre financier de Bahreïn accueille plus de 350 institutions bancaires et financières. Le pays est devenu un hub régional pour la finance islamique, avec 24 banques spécialisées et près de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le statut offshore du royaume et sa fiscalité avantageuse ont attiré d'importants flux de capitaux, notamment en provenance du Golfe.
Le tourisme constitue l'autre grand pilier de cette stratégie. Avec plus de 12 millions de visiteurs en 2023, principalement venus d'Arabie saoudite, le secteur connaît une croissance soutenue. Le royaume a investi massivement dans ses infrastructures : hôtels, centres commerciaux, complexes balnéaires et événements culturels. Objectif : faire de Bahreïn une destination de loisirs et d'affaires. D'ici les prochaines années, le gouvernement espère générer plus d'un milliard de dollars de recettes touristiques annuelles.
Des défis persistants
Derrière cette façade de modernité, les fractures sociales demeurent profondes. Le chômage touche particulièrement les jeunes chiites, qui accusent le pouvoir de favoritisme envers les sunnites. L'accès à la fonction publique, à l'armée et aux postes de responsabilité leur reste largement fermé. Certains quartiers chiites, comme Sitra ou Diraz, sont régulièrement le théâtre de tensions avec les forces de sécurité.
Sur le plan des libertés publiques, le pays reste sous étroite surveillance d'organisations internationales. Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent régulièrement des arrestations arbitraires, des procès inéquitables et torture dans les prisons. Malgré cela, Bahreïn reste un allié stratégique des puissances occidentales. Le royaume abrite la 5e flotte américaine, essentielle au contrôle du détroit d'Ormuz, et entretient des liens étroits avec le Royaume-Uni et la France.
En vingt ans, Bahreïn a certes transformé son économie et amélioré certains indicateurs de développement humain. Mais ces progrès restent fragiles tant que la réforme politique ne s'accompagne pas d'une véritable ouverture démocratique. Les concessions du pouvoir apparaissent souvent comme tactiques, destinées à désamorcer les critiques sans remettre en cause l'architecture autoritaire du régime.
À court terme, la stabilité du royaume repose sur deux piliers : le soutien indéfectible des monarchies voisines et la relative apathie d'une population divisée, fatiguée par la répression. À plus long terme, Bahreïn devra faire face à ses contradictions : concilier croissance et équité, sécurité et libertés, minorité au pouvoir et majorité chiite marginalisée.