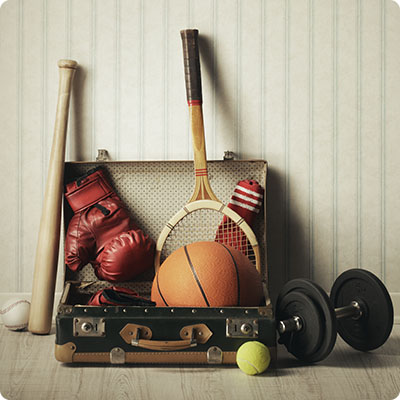Artificialisation des côtes
Pour faire face au manque de place de son très petit territoire, Bahreïn investit la mer en construisant des îles artificielles. Au sud-est de l'État, émergent ainsi les 15 îles en forme de croissant ou de poisson de Durrat Al Bahrain, un complexe résidentiel de luxe. Au nord, s'étend sur plus de 12 km2 de superficie le complexe Diyar Al Muharraq, construit comme une ville à part entière, avec ses commerces et habitations installés sur ce qui était autrefois le territoire de l'eau.
Car c'est bien là tout le problème : ces îles artificielles altèrent profondément le littoral. La faune et la flore dont la côte était autrefois l'habitat ont ainsi aujourd'hui complètement déserté la région. Malheureusement, le phénomène ne se limite pas aux côtes du Bahreïn, car tout autour du Golfe Persique, des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont recours aux mêmes méthodes de construction d'îles artificielles.
Une des créatures marines les plus impactées par ces constructions n'est autre que le corail. En effet, plusieurs zones de dragage, c'est-à-dire les fonds marins où l'on prélève de la matière qui viendra former les futures îles, sont situées sur des récifs coralliens, ou tout proches, et leurs sédiments recouvrent ainsi les coraux qui finissent étouffés. À l'inverse, certaines nouvelles îles s'installent directement sur des récifs, comme c'est le cas de Fasht Al Adhm, un projet d'archipel artificiel tirant directement son nom du récif, parmi les plus grands du golfe, qu'il recouvrira sur une surface de plus de 100 km2. Nombre d'espèces vivantes qui font des récifs leur zone de vie ou de reproduction voient, elles aussi, leurs populations se réduire comme peau de chagrin. C'est notamment le cas des poissons-clowns ou des raies. Une étude de 2009 du parlement du Bahreïn et de la Société de protection des pêcheurs a ainsi découvert que sur les 400 espèces de poissons qui fréquentaient autrefois les côtes de l'État, seules 50 y persistent encore aujourd'hui. Cette situation impacte pourtant directement l'Homme, puisque les pêcheurs reviennent de plus en plus souvent bredouilles, ou sont forcés de s'aventurer toujours plus loin pour remplir leurs filets, allant parfois jusque dans les eaux territoriales des États voisins, entraînant des conflits.
Réchauffement climatique
L'État insulaire est considéré comme le pays du Golfe Persique le plus menacé par la montée des eaux liée au réchauffement climatique. En effet, avec 161 km de côtes et un territoire particulièrement bas, avec un point culminant à seulement 134 m, Bahreïn est très vulnérable. Pour ne rien arranger, la population est concentrée sur les zones côtières les plus faibles en altitude, culminant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer. L'urbanisation de ces régions fragiles entraîne d'ailleurs une érosion importante, c'est-à-dire que le littoral s'affaisse et se dégrade.
Dans le même temps, l'eau monte à un rythme de 1,6 mm à 3,4 mm par an, ce qui pourrait conduire à une hausse de son niveau d'au moins 50 cm d'ici 2050. On estime que 5 à 18 % du pays pourraient alors être engloutis. Au-delà de ces suppositions, les conséquences de la montée des eaux sont déjà bien réelles, puisque les aquifères, ces nappes d'eau potable souterraines utilisées pour la consommation humaine, sont régulièrement infiltrés par l'eau de mer salée.
Le réchauffement climatique frappe aussi frontalement par des températures toujours plus élevées qui pourraient même finir par rendre le pays complètement inhabitable. Lors de l'été 2023, les températures stagnaient entre 40 et 45 °C, avec un taux d'humidité situé à 85 %, dû à l'évaporation des eaux du Golfe sous ces chaleurs extrêmes. La saison a alors battu le record de consommation électrique du pays, alors que les climatisations tournaient à plein régime.
Pourtant, bien qu'il en soit l'une des principales victimes, Bahreïn contribue très activement aux émissions de CO2, responsables du réchauffement climatique. L'industrie du pétrole et du gaz, sur laquelle repose son économie, est en effet particulièrement émettrice. Bahreïn est ainsi le sixième pays au monde avec les émissions de dioxyde de carbone par habitant les plus élevées. Depuis peu, voyant la fin de ses réserves pétrolifères se profiler, Bahreïn investit largement dans les énergies renouvelables. Cette nouvelle économie s'accompagne de promesses de durabilité, et c'est ainsi que l'État s'est engagé à réduire de 30 % ses émissions d'ici 2035, tout en cherchant à végétaliser son territoire et à quadrupler ses mangroves, qui le protègent de la montée des eaux. Pour l'heure, l'artificialisation du territoire a déjà fait disparaître jusqu'à 95 % des mangroves de certaines zones. Pour autant, ces bonnes volontés environnementales doivent concilier avec la puissante industrie pétrolière, comme on peut le remarquer en observant la structure du gouvernement, qui compte un « Ministère du Pétrole et de l'Environnement », deux objectifs peu compatibles…
Les zones protégées comme oasis de biodiversité
Le pays compte quelques zones protégées, essentielles pour sauvegarder la faune et la flore, bien que celles-ci soient de taille très réduite et insuffisantes en nombre. La réserve de vie sauvage d'Al Areen, dans l'Ouest du pays, a ainsi été créée sur une zone de 5,4 km2 pour faire office de réservoir d'êtres vivants indigènes. En effet, certaines espèces animales de l'île menacées d'extinction y sont gardées en captivité, notamment pour participer à des programmes de réintroduction. Une partie du parc est exclusivement réservée aux biologistes, tandis que l'autre est visitable, à condition d'être accompagnée d'un guide. Les îles Hawar, un chapelet d'îles faisant face au Qatar, qui les a longtemps convoitées, constituent l'unique réserve naturelle significative du Royaume. Seule une des îles compte quelques bâtiments, mais l'archipel est globalement une réserve protégée vierge, qui fait le bonheur de mammifères très rares et surtout d'oiseaux. Les eaux territoriales des îles Hawar font elles aussi l'objet d'un programme de conservation. Depuis deux décennies, Bahreïn commence en effet à préserver des zones marines, à l'image de la réserve Hayr Bulthama, au Nord, déclarée zone marine protégée depuis 2008.