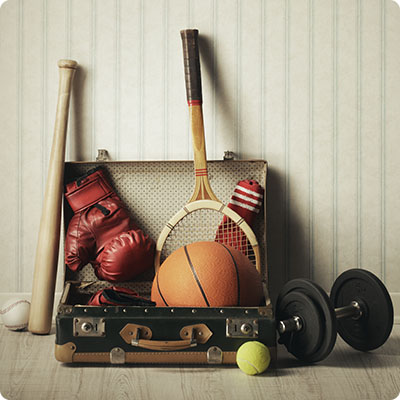La perle : un mythe antique
Les premières traces archéologiques de pêche à la perle dans la région remontent à près de 4 000 ans. Dans l'Épopée de Gilgamesh, le secret de l'immortalité que le héros vient chercher dans ces îles mystérieuses pourrait être, selon les historiens, ces fameuses perles. À l'époque de Dilmun, les tablettes mésopotamiennes évoquent déjà les « pierres brillantes » venues du sud. Bahreïn tirait parti de ses fonds marins et de l'huître Pinctada radiata, réputée pour produire des perles d'une finesse exceptionnelle. Ces joyaux naturels sont le résultat d'un processus d'autodéfense des huîtres : quand des parasites attaquent le coquillage, il se protège en formant une boule de nacre. Des sécrétions qui forment ces perles parmi les plus belles du monde : elles séduisent très tôt les grandes civilisations du monde méditerranéen — Grecs, Romains, puis plus tard, les Vénitiens, les Moghols ou les Ottomans, qui s'arrachent ces perles rares.
Au XIIIe siècle, Marco Polo mentionne dans ses récits les perles du Golfe. Des siècles plus tard, elles ornent les parures des élites d'Istanbul et de Delhi, puis les cours européennes. La maison Cartier, au début du XXe siècle, en fit l'un de ses matériaux fétiches : Jacques Cartier, lors d'un voyage dans le Golfe, s'arrêta à Bahreïn pour y sélectionner lui-même les plus belles pièces, qu'il destinait aux colliers de la noblesse anglaise ou aux diadèmes de la haute bourgeoisie française. Les perles de Bahreïn, irrégulières mais éclatantes, se sont alors hissées au sommet du luxe mondial.
Une économie et une société structurées par la mer
À partir du XVIIIe siècle, la pêche perlière devient la première source de revenus de l'archipel. Chaque année, la grande saison (ghaus al-kabir) débute en mai et mobilise des milliers d'hommes. Les bateaux sont dirigés par des nakhudas — capitaines expérimentés — qui recrutent des plongeurs (ghawwās), des rameurs (saib) et des assistants. Les expéditions, d'une durée de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sont menées sans escale. À bord, les hommes dorment à la belle étoile, soumis à la chaleur écrasante, à la faim, aux tempêtes du Golfe ou aux requins.
Les plongeurs descendent au fond de la mer à l'aide de pierres servant de poids, puis enchaînent des dizaines de descentes par jour, jusqu'à dix mètres de profondeur. Munis de paniers en corde et de pinces nasales en cuir, ils raclent les fonds marins, espérant découvrir l'huître qui cache une perle exceptionnelle. La majorité des coquillages sont vides ou contiennent des perles déformées. Seule une infime minorité renferme une Dana : perle parfaitement ronde, nacrée, d'une valeur inestimable.
Une société tournée vers la mer
La société perlière suit une structure rigoureuse, presque féodale. Chaque membre de l'équipage, du capitaine au plus jeune assistant, a un rôle bien précis et une part définie du butin. Les nakhudas, à la fois capitaines et investisseurs, sont souvent des notables locaux, les seuls à connaître les secrets de la mer, et s'appuient sur un réseau de relations commerciales. Ils recrutent leur équipage à crédit, en avance sur les gains espérés. Ce système crée une dépendance économique forte, notamment pour les ghawwās, les plongeurs, dont la bravoure est certes mise en valeur, mais qui vivent le plus souvent dans une précarité abjecte.
Les ghawwās sont des hommes jeunes, robustes, souvent issus de familles modestes de Muharraq ou de Sitra. Leur quotidien est rythmé par des efforts physiques extrêmes : ils travaillent entre dix et douze heures par jour. Plonger en apnée est un métier dangereux : syncope, noyade, blessures internes dues à la pression… À chaque descente, ils risquent leur vie. Mais une fois revenus à terre, ils sont célébrés comme de véritables héros. Leur chant funèbre (fidjeri) est considéré comme l'un des héritages les plus importants de la culture maritime du Golfe. On dit même qu'un bon plongeur doit connaître autant de chants que de techniques de plongée. Ces mélodies, transmises oralement de génération en génération, sont à la fois des prières pour s'assurer du retour à terre et des récits légendaires, évoquant la mer comme amante, ennemie ou mère nourricière.
Les rameurs, eux, sont généralement moins bien considérés, mais indispensables à la navigation et à la logistique à bord. Le siyub, celui qui aide le plongeur à remonter à la surface en tirant la corde, joue un rôle vital dans la survie du ghawwās. Cette solidarité devient souvent un lien indéfectible entre les hommes d'équipage. Des relations qui se prolongent à terre : les familles vivant de la pêche de la perle s'unissent souvent par le mariage.
Chaque été, à l'approche de la saison, la ville de Muharraq est en effervescence : les artisans réparent les coques des boutres, les mères tressent les cordes, et les imams lisent des versets du Coran pour bénir les expéditions. Les hommes partent avec une poignée de dattes, du poisson séché, une jarre d'eau douce... On leur confie des amulettes pour les protéger de la noyade. À leur retour, à la fin de l'été, c'est toute la communauté qui se réunit sur les quais pour accueillir ceux qui ont eu la chance de survivre — et pleurer les disparus.
L’apogée puis le déclin
L'industrie perlière de Bahreïn atteint son apogée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On estime qu'un tiers de la population dépend alors directement ou indirectement de cette activité : dans les années 1930, plus de 30 000 personnes vivent de cette industrie. Les perles bahreïnies, vendues jusqu'à Paris ou Tokyo, deviennent le nec plus ultra du luxe et de l'élégance. Albert Londres, lors de son passage dans le Golfe dans les années 1930, consacre quelques lignes enthousiastes à ces hommes « qui plongent au fond de l'eau pour chercher le silence et rapportent la lumière ».
Mais cette prospérité est brutalement interrompue par deux événements majeurs. D'une part, la mise au point au Japon des perles de culture par Kokichi Mikimoto rend les nacres naturelles moins compétitives. Produites en masse, uniformes et bien moins chères, ces perles industrielles inondent le marché mondial. D'autre part, la découverte du pétrole à Bahreïn en 1932 détourne l'économie de la mer vers la terre. Le modèle perlier s'effondre : les boutres sont abandonnés, les chantiers navals désertés, les savoir-faire oubliés.
Un héritage préservé
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis les années 2000, les autorités bahreïniennes se mobilisent pour restaurer cet héritage fondamental de leur identité. Le « Sentier des perles » à Muharraq, inscrit en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO, relie sur 3,5 kilomètres 17 bâtiments historiques, trois sites côtiers et un ancien port. Il permet de revivre le quotidien des familles perlières, de comprendre l'organisation sociale et de voir les lieux où étaient préparées les expéditions.
Le musée national de Bahreïn expose une collection unique d'objets liés à cette époque : outils de plongée, bijoux anciens, instruments de navigation. Certaines perles datent du Ier siècle après J.-C., d'autres proviennent directement de commandes passées par des joailliers européens à des marchands locaux. On y trouve même des extraits de carnets de bord annotés par des négociants français.
Le Festival de la mer, organisé chaque année, propose compétitions nautiques, démonstrations de plongée traditionnelle et chants fidjeri. Certains jeunes Bahreïniens apprennent encore à plonger à l'ancienne, en apnée.
La perle, symbole de Bahreïn
Aujourd'hui, Bahreïn est le seul pays au monde où la pêche à la perle naturelle est encore pratiquée légalement, sous licence et quotas stricts. Quelques artisans joailliers continuent à travailler exclusivement avec ces perles naturelles, les dernières à être encore récoltées en mer. Offerte lors des mariages, transmise de mère en fille, la perle reste chargée d'émotion et de mémoire.
Mais plus encore, elle devient une clé de lecture de l'identité bahreïnienne contemporaine. Dans un pays en pleine mutation, happé par la mondialisation et les changements radicaux qui bouleversent le monde, le souvenir de ces hommes qui risquaient leur vie au fond de la mer est devenu un marqueur identitaire. Le gouvernement, via l'Autorité pour la culture et les antiquités, ressuscite ce passé pour en faire une partie intégrante du roman national bahreïni.
Dans les écoles, les manuels d'histoire racontent désormais la vie des pêcheurs d'antan. Les enfants visitent les maisons restaurées des nakhudas, écoutent des enregistrements de fidjeri et apprennent à identifier les outils traditionnels. Un devoir de mémoire, soutenu et financé entre autres par l'UNESCO et le gouvernement, qui a sauvé de l'oubli cette culture millénaire : au XXe siècle, ce peuple insulaire s'était détourné de la mer. À Manama, par exemple, le centre culturel Dar Al Muharraq organise des ateliers où d'anciens plongeurs racontent leur vie en mer à des lycéens. De quoi, peut-être, susciter des vocations.
Dans les arts, la perle inspire une nouvelle génération de créateurs : sculptures de nacre, installations contemporaines, bijoux épurés ou poèmes chantant la beauté de la mer refont surface. Même les architectes s'en inspirent : à Diyar Al Muharraq, une nouvelle ville en bord de mer, certains immeubles adoptent des formes évoquant des huîtres entrouvertes, tandis que les rues sont ornées de mosaïques représentant les anciennes routes maritimes. La perle devient également un objet diplomatique : offerte aux chefs d'État ou exposée dans les salons internationaux, elle raconte un Bahreïn profondément ancré dans son histoire, à rebours des clichés sur la région. Pour de nombreux Bahreïniens, les souvenirs de la mer restent gravés dans la mémoire familiale : les grands-pères étaient plongeurs ou capitaines, les grandes-mères vendaient les coquillages ou brodaient les habits des marins. Et ce n'est probablement pas un hasard si les manifestants du Printemps arabe ont établi leur quartier général sur la Place de la perle de Manama.
Aujourd'hui, une nouvelle génération de pêcheurs reprend le flambeau. Si les plongeurs sont désormais équipés de bouteilles et ne risquent plus leur vie à multiplier les descentes en apnée, les perles de Bahreïn sont toujours aussi belles qu'il y a 5 000 ans.