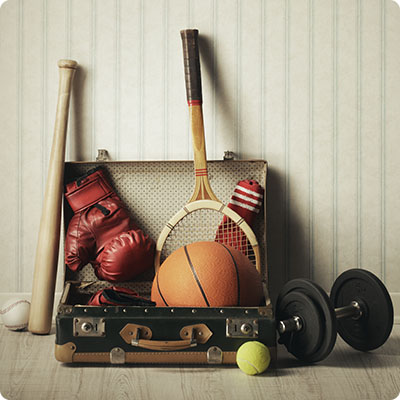L’influence chinoise
Le chinois permit de figer à l'écrit des actes administratifs et juridiques, puis se fit langue liturgique. En effet, au IVe siècle, le pays ne possédait pas de système d'écriture. Bien qu'il ne fût pas simple de transposer la prononciation japonaise avec des signes chinois (kanjis), et que l'alphabet allait considérablement évoluer (en kanas, se décomposant en katakanas, notamment pour les mots étrangers, et en hiraganas, donc en sons obtenus par l'agglomérat de kanjis), l'écriture fut une véritable révolution. Elle constitua pour les représentants du pouvoir impérial la possibilité de s'imposer. L'impératrice Genmei commanda au conteur Hieda no Are un recueil : le Kojiki (Chronique des faits anciens). Achevé en 712, écrit en japonais mais avec des signes chinois, il est considéré comme le plus ancien texte du Japon. Dans un souci d'inventaire, le VIIIe siècle voit composés des fudoki sur la géographie et les traditions, mais ce sont les anthologies poétiques qui marquent un tournant littéraire. Ainsi, il faut mentionner le Man'yōshū qui contient près de 4 500 poèmes japonais (wakas, à ne pas confondre avec la forme chinoise, le kanshi, qui fit l'objet d'une autre anthologie, le Kaifūsō) et livre les clefs du tanka dont la métrique (31 « pieds » sur cinq « vers » non rimés) sera longuement prisée.
Une affirmation rapide
Le Conte du coupeur de bambou s'inspirerait d'une histoire tibétaine. Apparaissent des genres propres à l'archipel, comme le monogatari (récit) et le nikki (journal intime) : Le Dit du Genji et Notes de chevet, textes fondamentaux attribués à deux dames de cour du début du XIe siècle. Au siècle suivant, le Japon entre en guerre civile, engendrant des chroniques guerrières (gunki monogatari). D'abord orales grâce aux biwa hōshi, des prêtres souvent aveugles, elles sont figées à l'écrit, parfois dans de multiples versions comme le fut Le Dit des Heike. Ce texte viendra alimenter un art qui connaît alors une pleine évolution : le théâtre nô (voir dossier « Musique et scènes »). À partir du XIIIe siècle émerge une littérature écrite par des moines bouddhistes (Notes de ma cabane de moine de Kamo Chômei, Les Heures oisives de Yoshida Kenko…). Le Otogi-zōshi référence plus de 300 courts textes de l'époque médiévale, le Shinshokukokin wakashū se fait anthologie poétique, la Littérature des Cinq montagnes englobe la production issue des monastères de la branche Rinzai du bouddhisme zen, et l'école poétique Nijō s'ingénie à compiler des wakas…
L’époque d’Edo
L'époque d'Edo (début du XVIIe - mi-XIXe siècle) rythme des évolutions de la société japonaise. Fujiwara Seika (1561-1619) crée une école néo-confucéenne, le christianisme est interdit suite à la rébellion de Shimabara (1637-1638). Dans le même temps, le mode de vie urbain se développe : c'est l'apparition du « monde flottant ». Asai Ryōi l'explique dans Ukiyo-monogatari : la brièveté de l'existence incite à profiter de chaque amusement de l'instant présent. Bien loin de son sens bouddhique originel, l'ukiyo d'alors campe plutôt l'atmosphère des maisons de plaisir ou de divertissements, et donne naissance à une littérature (parfois érotique), l'Ukiyo-zōshi, dans laquelle excelle Ihara Saikaku (1642-1693) avec L'Homme qui ne vécut que pour aimer. Parmi les auteurs réputés de l'époque : Bashō (1644-1694), grand maître du haïku (trois vers de successivement 5, 7 et 5 syllabes), puis Buson (1716-1783) puis Issa (1763-1828). Dans le domaine du théâtre, Chikamatsu Monzaemon (1653-1725) écrit ses pièces pour des marionnettes (genre du jôruri, futur bunraku) avant de les transposer pour la scène du kabuki.
Apparaissent des « livres de lecture », très peu illustrés contrairement aux kibyōshi (« couverture jaune ») alors très populaires : voir par exemple les Contes de pluie et de lune d'Akinari Ueda (1734-1809) et le roman picaresque À pied sur le Tokaido d'Ikku Jippensha.
Ouverture, expansion et mangas
En entrant dans l'ère Meiji en 1868, le pays s'ouvre au monde et à la modernité. Ces changements se prêtent aux réflexions philosophiques. Puis, marqué par de nombreux drames et par les bombardements atomiques de 1945, le XXe siècle n'en est pas moins celui de l'expansion, avec de plus en plus de traductions, quand on songe par exemple aux mangas qu'il est impossible de ne pas évoquer ou de réduire à une simple version japonaise des bandes dessinées. Ce genre si particulier puise ses racines à l'époque Nara (entre 710 et 794 de notre ère !) où apparaissent des rouleaux peints racontant une histoire, les emakimono. Si, au début, le texte et le dessin étaient nettement séparés, bientôt l'image existe de façon autonome sous le pinceau de Katsushika Hokusai (1760-1849), connu pour ses estampes (dont sa fameuse Grande Vague de Kanagawa) mais aussi ses croquis pris sur le vif, les « Hokusai manga ».
C'est pourtant un Australien, Frank Arthur Nankivell (1869-1959) qui forme le premier « mangaka » de l'histoire, Rakuten Kitazawa (né Yasuji Kitazawa en 1876 à Ōmiya-ku). Il finira par quitter le magazine Box of Curios où il avait été initié, rejoindra le Jiji shimpō puis lancera son propre titre, le Tokyo Puck, en 1905. Plutôt mordant envers le pouvoir, il se fera plus discret après les arrestations massives de 1910. Sa première BD humoristique, qui est donc le premier manga de l'histoire au sens strict du terme, publié en 1902, reprenait le thème de l'arroseur arrosé du court-métrage des frères Lumière ; puis il imagine des personnages japonais tels que Nukesaku Teino, « tête en bois, idiot », ou Tonda Haneko, véritable garçon manqué.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est occupé par les Américains, friands de « comics ». Osamu Tezuka bénéficie d'une large audience dès qu'il fait paraître La Nouvelle île au trésor en 1947, un manga d'aventure qui se vend à plus de 400 000 exemplaires ! Jusqu'à son décès précoce en 1989, il enchaînera les succès et les récompenses. Il aura composé plus de 700 œuvres au rayonnement international : Astro, le petit robot, Le Roi Léo, Black Jack… Un prix porte son nom et est remis chaque année à un mangaka émérite.
La littérature contemporaine
En 1968, Yasunari Kawabata (1899-1972) devient le premier Japonais à recevoir le prix Nobel de Littérature, puis en 1994, c'est Kenzaburō Ōe, né en 1935, puis en 2017 Kazuo Ishiguro, né en 1954 à Nagasaki mais qui demanda en 1983 la nationalité du pays qui le vit grandir, l'Angleterre. De nombreux écrivains constituent une porte d'entrée sur la littérature japonaise moderne, comme Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965) (Quatre sœurs, Le Goût des orties, Svatiska), Masuji Ibuse (1898-1993) qui avec Pluie noire évoque Hiroshima, Yasushi Inoue (1907-1991) (Le Fusil de chasse), le très envoûtant Kōbō Abe (1924-1993) avec La Femme des sables, ou Yukio Mishima qui se suicida par seppuku en 1970 et dont l'œuvre est représentative de la littérature japonaise (Confessions d'un masque, Le Pavillon d'or, Dojoji), et Akira Yoshimura (1927-2006) (Le Grand tremblement de terre du Kantô, Le Convoi de l'eau).
Haruki Murakami, Yōko Ogawa et Ito Ogawa sont des noms qui nous sont devenus très familiers. Le premier, né en 1949 à Kyoto, vend des millions d'exemplaires à travers le monde. Il ne cache pas de l'influence d'auteurs américains. Récipiendaire du Prix Gunzō dès son premier roman, Écoute le chant du vent en 1979, c'est avec La Course au mouton sauvage (1982 au Japon, 1990 en France), puis avec La Fin des temps qu'il se fait repérer. Viennent ensuite La Ballade de l'impossible, Danse, danse, danse, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil… ! Yōko Ogawa connaît à peu près le même parcours, puise son inspiration également dans la littérature américaine, aime aussi ponctuer ses atmosphères d'une note d'étrangeté tout en abordant « par la marge » des thèmes comme la violence, l'enfermement… dans ses romans (Le Musée du silence, Parfum de glace, Hôtel Iris…) ou ses recueils de nouvelles (La Piscine, La Grossesse, Les Abeilles…). Sa quasi homonyme Ito Ogawa, née en 1973, est surtout connue pour son premier roman, Le Restaurant de l'amour retrouvé. En 2021, en France, c'est au tour de Tant que le café est encore chaud (Toshikazu Kawaguchi) de rencontrer un beau succès. Les éditeurs français ne s'y trompent pas et laissent une belle place dans leur catalogue aux romans traduits du japonais. L'éditeur incontournable reste Picquier qui, depuis 1986, s'est spécialisé dans les livres venus d'Extrême-Orient.