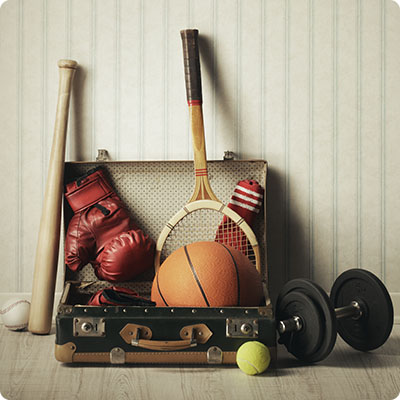La musique traditionnelle
La tradition musicale japonaise raconte à sa manière la construction et les mouvements de l'archipel. À l'époque Asuka (592-710), avec l'introduction du bouddhisme dans le pays, apparaissent des danses rituelles masquées. Véhicule de la transmission de la sagesse, la musique devient reine et l'empereur Monmu (697-707) établit même un Ministère de la musique. À l'époque Nara (710-793), brillante artistiquement, la musique chinoise (de la dynastie T'ang) pénètre massivement sur le territoire, comme celles d'Inde, de Perse et d'Asie centrale. À cette époque s'officialise le gagaku (« musique élégante »). Musique de cour officielle, pratiquée aussi dans les temples, le gagaku se base sur les théories musicales et instruments importés des royaumes de Chine et Corée. Inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, le gagaku n'est plus aujourd'hui (uniquement) une musique de cour mais continue d'être joué par de grands ensembles. La danse qui accompagne le gagaku se nomme bugaku et brille par la grâce et la majesté de ses mouvements et l'élaboration des costumes.
Durant l'ère Nara apparaît le shōmyō, originaire d'Inde. Psalmodie bouddhiste, le style gagne rapidement la faveur des aristocrates et des fonctionnaires. C'est dans le shōmyō, chant et liturgie, que se constitue une unité fondamentale : la cellule mélodique. Durant l'ère Kamakura (1185 – 1333), période de renouveau religieux, se développe l'art du biwa (luth à quatre cordes) en même temps que les chants bouddhiques. Durant le haut Moyen Âge (XIe-XVIe siècle) s'épanouissent des musiques dites « rustiques », que l'on considère souvent comme ancêtres du théâtre nō.
La musique japonaise va prendre un véritable essor durant l'époque Edo avec l'arrivée de l'emblématique shamisen, luth à long manche et trois cordes. Une unité des instruments se développe avec le koto, la harpe horizontale, le luth biwa et la flûte de bambou shakuhachi, d'origine chinoise. De cette époque, tous les genres musicaux modernes japonais ont conservé des tempi élastiques.
Pour écouter de la musique traditionnelle japonaise, se diriger vers les albums des frères Yoshida (Yoshida Kyōdai), excellent duo de shamisenistes. Un brin plus confidentiel mais fabuleux, Kimio Eto (1924-2012) fut l'un des grands artistes du koto.
Au Japon, une opportunité est d'assister à un matsuri. Riches en musique et folklore local, ces fêtes populaires sont célébrées un peu partout dans le pays tout au long de l'année.
Musique classique
Arrivé au début de l'ère Meiji (1868 – 1912), le genre doit énormément à Shuji Isawa (1851-1917), envoyé aux États-Unis pour étudier l'enseignement, la pratique et la diffusion de la musique. Dès son retour, le gouvernement Meiji fait le choix radical de rendre obligatoire l'instruction de la musique occidentale à l'école primaire et secondaire. Autre événement contribuant à la propagation de la musique classique sur le territoire, l'occupation américaine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale (1945 – 1952).
Aujourd'hui, dès l'école primaire, les enfants apprennent la musique. Depuis les années 1960, le pays est une destination prisée des plus grands noms internationaux, attirés par la qualité des salles et la générosité du public.
Outre Toru Takemitsu (1930 – 1996) – un point de jonction entre Cage, Debussy et la tradition japonaise - souvent désigné à juste titre comme le chef de file de la musique classique japonaise, la liste de compositeurs excellant dans le domaine est longue. Citons Teizō Matsumura (1929 – 2007) à l'œuvre influencée par Ravel et Stravinsky, Toshio Hosokawa qui pensait ses compositions comme une « calligraphie sonore » ou encore Yasushi Akutagawa (1925 – 1989) proche de Dmitri Chostakovitch et Aram Khatchatourian qui fut le seul compositeur japonais dont les œuvres ont été officiellement publiées en Union soviétique. Le pays compte aussi un géant de la direction d'orchestre, Seiji Ozawa, chef de file de l'école japonaise et un des plus grands spécialistes de la musique française du XXe siècle. Dans ses pas, marchent Kazushi Ōno, connu en France pour avoir dirigé l'orchestre de l'Opéra national de Lyon en 2008/09 et surtout Kazuki Yamada, figure montante nommé à la tête de l'Orchestre symphonique de Birmingham à partir de 2023.
Côté interprètes, impossible de ne pas mentionner Yōko Watanabe (1953 – 2004), soprano japonaise dont l'essentiel de la carrière a été consacrée au rôle-titre de Madame Butterfly dans toute l'Europe, Mitsuko Uchida, pianiste virtuose réputée pour ses interprétations de Schubert, Chopin et Debussy, Nobuyuki Tsuji, pianiste star au Japon et étoile montante sur la scène internationale et bien entendu Ryuichi Sakamoto, pionnier de la musique électronique et une sorte d'Erik Satie du classique contemporain.
Les musiques actuelles
Au pays du Soleil Levant, aujourd'hui, tous les styles occidentaux modernes semblent avoir trouvé leur traduction. Rap, rock, jazz, pop, variété... la musique japonaise a assimilé beaucoup de genres aux codes du pays. La J-pop, un genre musical devenu dominant à la fin des années 1990, désigne le grand nombre de girls et boys band se produisant au Japon. Elle fait suite à la city pop des années 1980, mélange de disco-funk typiquement japonais et au shibuya-kei des années 1990, fusion kitsch de pop sixties occidentale et de variété locale. Aujourd'hui, le genre est invariablement une mine d'or. Quartier des jeunes Tokyoïtes par excellence, Harajuku est le berceau et le point de rencontre de cette culture J-pop. Autrefois niche de la contre-culture, il est toujours très animé mais aujourd'hui plus excentrique qu'anticonformiste.
L'ambient au Japon est une musique particulièrement prisée et respectée. Souvent dénommée kankyō ongaku, pour « musique environnementale », elle n'est pas comparable à ce que Satie appelait de la musique d'ameublement. Elle est conçue pour habiter l'espace intérieur. Satoshi Ashikawa est un pionnier du genre au Japon, fils spirituel de Brian Eno. Citons également Jun Fukamachi. Autre figure culte, Hiroshi Yoshimura est un fabuleux peintre sonore, auteur de compositions où triomphent la paix et l'harmonie.
Le cas du hip-hop est au Japon un brin particulier. La langue japonaise, dans sa construction grammaticale, rendait de prime abord impossible l'idée d'un rap japonais. Et si les premiers MCs se sont d'abord tournés vers l'anglais pour s'exprimer, les rappeurs locaux ont vite trouvé des astuces pour adapter le japonais au genre. Et comme partout ailleurs sur la planète, le hip-hop a pris d'assaut la culture locale.
La danse et le théâtre
La musique, la danse et le théâtre ne font souvent qu'un dans la tradition japonaise. Le théâtre japonais renvoie aux grands mythes shintō et aux légendes séculaires. C'est particulièrement visible dans le kagura, la forme la plus ancienne de danse théâtrale au Japon. Associé au culte shintō, il est souvent joué à l'occasion des matsuri.
Le gigaku a possiblement été introduit au Japon au VIIe siècle. Accompagnant à l'origine les rites bouddhiques, il consiste en un défilé de danseurs portant d'immenses masques, lors de danses rituelles exécutées au temple, et parfois accompagnées de mimes pour amuser le public.
Bien que le nō ait gardé de lointains liens avec la religion bouddhique et les rites shintō, il est avant tout une danse profane. Il est caractérisé par son jeu épuré, codifié et tout en symboliques, ne racontant pas une intrigue mais exprimant une émotion ou une atmosphère. Ce nō fut une des premières formes artistiques à être inscrites (en 2008) au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Intermèdes permettant de tirer le spectateur du nō, les kyōgen (bouffonneries ou farces) sont souvent dénigrés et rangés dans le registre des arts mineurs. Et pourtant… ces sortes de petits sketchs ont une valeur dramaturgique à part entière. Voir une représentation de nō est un incontournable lors d'un séjour au Japon.
Signifiant « exubérant et marginal », le kabuki désigne sans doute à l'origine un théâtre d'avant-garde ; il est désormais la forme de théâtre traditionnel la plus populaire. Datant de l'époque Edo, au début du XVIIe siècle, il illustre des événements historiques ou des conflits moraux. Les acteurs s'y expriment d'une voix monotone et sont accompagnés d'instruments traditionnels.
Dernière forme très populaire de théâtre japonais, le bunraku est exécuté avec des marionnettes de grande taille, manipulées à vue tandis qu'un seul et même récitant joue tous les rôles.