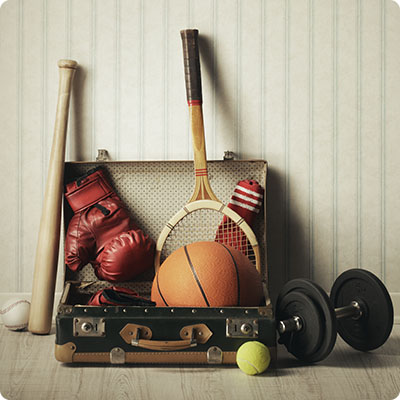Matériaux et principes de construction
La plupart des matériaux de construction au Japon sont d'origine végétale. Le matériau le plus utilisé pour les édifices traditionnels et pour les maisons est le bois de résineux. Les feuillus servent à fabriquer les meubles. Le travail du bois a permis de créer la technique de l'ossature. Les murs ne sont pas porteurs et distribuent l'espace en fonction des besoins. Les panneaux sont coulissants (shôji ou fusuma) voire amovibles. Leur remplissage est constitué de feuilles de mûrier qui laissent passer la lumière. Enfin, le bambou sert pour les lattis de bois, enduit d'un mélange d'argile, de sable et de paille hachée pour réaliser les murs. Doux et résistants, les tatamis sont constitués de paille de riz battue et pressée, recouverte d'une natte d'herbe tissée. La dimension du tatami est fixée dans l'espace par deux colonnes, le ken, soit en moyenne 1,86 m x 0,93 m. Deux tatamis constituent un carré d'une surface d'un tsubo, soit 3,46 m².
À partir de l'époque Muromachi (entre 1336 et 1573), une standardisation donne le fondement de l'esthétique. On construit sur pilotis. Le bâtiment est horizontal pour mieux s'immiscer dans la nature. L'engawa sert de trait d'union entre l'habitation et le monde extérieur. Entre l'engawa et les pièces adjacentes se dressent les shoji. Ces panneaux coulissants et les coursives permettent de connecter extérieur et intérieur mais aussi de capter et diffuser la lumière. Si l'architecture japonaise a emprunté largement au système chinois l'adoption des principes de toiture, elle s'en est détournée en abandonnant la rigueur des éléments de la géomancie chinoise. Toute la subtilité japonaise se concentre sur le refus du monumental et un équilibre particulier entre les espaces et les volumes.
Constructions postérieures
Une dissymétrie de la section transversale permet d'aménager un espace à des fins rituelles pour les fidèles. Une structure indépendante de la structure primitive dégage un nouvel espace devant l'image sainte. Pour conserver la construction symétrique du toit, on eut recours à deux innovations : un double système de poutres, ou la liaison entre les colonnes, qui repose sur la taille des poutres et des poteaux jusqu'à l'ajustement de ceux-ci. La charpente japonaise s'affranchit de la charpente chinoise.
Plus tard, les procédés d'assemblage mettent au point des encorbellements et la construction rationnelle les angles des toits. Les dimensions des sanctuaires, des temples et des maisons obéissent aux mêmes lois : le kendōnt. La dimension locale varie entre 1,80 m et 1,90 m. Le bois est laissé au naturel ce qui permet d'admirer son grain, de le patiner avec les intempéries et de résister aux changements de température et à l'humidité. D'ailleurs, les Japonais utilisent le jeu du bois en fendant les piliers afin qu'en gonflant ceux-ci ne se déforment pas et puissent épouser les mouvements du sol lors des tremblements de terre.
Architecture résidentielle
La codification des éléments architecturaux s'intensifie à partir de l'époque Nara (entre 710 et 794) puis de l'époque Heian (794-1192). Elle prend le nom de Shinden ou Shinden-zukuri. La résidence, réservée aux familles nobles, comprend un bâtiment principal (shinden) entouré sur trois côtés de bâtiments annexes (taï no ya) reliés au bâtiment principal par des coursives. Devant la résidence se trouve un étang avec des îlots réunis par des ponts. Toutes ces constructions obéissent à la géomancie chinoise. Les ruisseaux qui alimentent l'étang doivent être orientés selon un axe nord-ouest sud-est. Les murs sont constitués de vantaux (shitomido) qu'on place ou déplace selon les saisons. On trouve en plus des pavillons reliés par des galeries couvertes et des postes de garde. L'ensemble est clos et percé de plusieurs portes disposées aux points cardinaux. Celle du sud faisait office de porte principale. Ces résidences ont aujourd'hui totalement disparu. Il ne nous en reste que des témoignages sur les rouleaux (emakimono) qui datent de l'époque Heian.
À l'époque Kamakura (de 1185 à 1333) se développe un style particulier pour les résidences de samouraïs avec un bâtiment principal situé sur un terrain clos. Autour se trouvent des appentis pour la cuisine et les chevaux. Derrière s'étend un jardin dont le style reprend les grandes lignes du style shinden, mais qui, peu à peu, s'inspire des jardins Zen.
À partir de l'époque Muromachi (entre 1336 et 1573), des modifications importantes surviennent : l'apparition du tokonoma comme alcôve symbolique et la standardisation des tatamis. Apparaît également l'architecture si caractéristique des maisons de thé (sukiya). D'inspiration chinoise, ce style s'applique aux résidences aristocratiques de la fin du XVIe siècle. Le plan carré est orienté nord-sud avec l'entrée principale au sud. La porte (chū-mon) ouvre sur le bâtiment principal par une véranda qui entoure cette construction. À la place des portes suspendues en bois sont installés les shōji (les panneaux coulissants en bois léger quadrillé et dont les vides sont recouverts de papier blanc translucide), protégés des éléments par des volets réticulés en bambou fin. Les tatamis recouvrent les planchers.
Architecture bouddhiste
D'abord, un pavillon où sont installées les images et les sculptures pieuses, le kondō, puis un pavillon à destination didactique, le kōdō, réservé à l'enseignement des religieux et aux sermons, une pagode, et généralement des quartiers monastiques qui font figure d'enceinte.
Le plus vieux temple bouddhiste japonais est le Hōryū-ji, à Ikaruga près de Nara. Ce temple représente aujourd'hui la plus vieille structure en bois du monde. Bâti au début du VIIe siècle par Shotoku Taishi, les 2300 structures architecturales du Hōryū-ji plongent le visiteur dans une autre ère.
Par la suite, une scrupuleuse orthodoxie est respectée dans l'agencement des bâtiments par rapport à l'axe sino-coréen. À Nara, l'ancienne capitale impériale, le majestueux Tōdai-ji (grand temple de l'Est) fut commandé en 743 par l'empereur Shômu. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le plus haut édifice couvert en bois au monde. Reconstruit plusieurs fois, l'apparence actuelle du Tōdai-ji date des apports de l'époque d'Edo (1603-1868).
À l'est de Kyōto, avant même qu'elle ne devienne la nouvelle capitale (de 794 à 1868), est construit le temple Kiyomizudera à flanc de montagne en 780. Pour établir les édifices des sectes Tendaï et Shingon, l'architecture va s'affranchir de ses modèles : utilisation des courbes de niveau dans les montagnes, nouveaux axes de symétrie et nouvelles perspectives. Avec la nouvelle capitale et le développement du culte d'Amida, plusieurs temples sont orientés vers l'est pour faire face au paradis de l'ouest. Les styles de construction des temples bouddhiques relèvent de trois tendances : le wa-yō (japonais, période Kamakura), le kara-yō (chinois) et enfin le tenjiku-yō (périodes Kamakura et Muromachi).
Architecture shintō
Cette architecture naît pendant la période Yayoi (300 av. J.-C. et 250 après J.-C.). Les toitures sont à double pente et les cloisons faites de planches juxtaposées. Ce style d'architecture employé pour les kura (greniers) sera transformé plus tard en procédé azekura-zukuri afin de bâtir de grands sanctuaires, comme Ise-Jingu et Izumo Taisha. Par la suite, onze styles différents marquent une progression dans la maîtrise de l'espace, fortement influencés par les procédés de construction bouddhiques, dont le style Taisha, le style Shimmei, le style Ōtori, les styles Kasuga et Nagare, le style Hachiman, et le style Gongen.
Le wabi et le sabi
Le sabi, esthétique développée durant la période Muromachi, est le concept de rigueur et de sobriété : ce qui importe, c'est l'essence des choses et non leur apparence. Cette exigence esthétique se retrouve dans la cérémonie du thé (cha-no-yu) et dans l'architecture des pavillons de thé (chashitsu). Il compte un sentiment de résignation. Dès le XIIe siècle, il est développé en littérature et en poésie.
Le wabi désigne le détachement, une espèce de langueur. Développé à l'ère de Kamakura, il perdura comme une composante esthétique. Il s'approche de la rusticité, avec un mouvement de solitude et de simplicité. Il doit tendre vers la beauté pure et désintéressée des choses.
Ces deux concepts, sabi et wabi, sont rejoints par le yūgen, tentative de recouvrir les choses d'une délicate pellicule de mystère et de beauté ; avec parfois tristesse et mélancolie. C'est dans le Nō (XVe siècle), que l'on travaille à ce sentiment de suggestion plus qu'à sa description. Dans l'art de la peinture, on retrouve également avec le yojō cet esprit suggestif. On parle également du shibui, un raffinement qui se cache derrière une apparente banalité. En littérature, le shibui, le wabi et le sabi sont appelés heitammi, lorsqu'on est arrivé à vaincre toute chose inutile ou tout maniérisme.