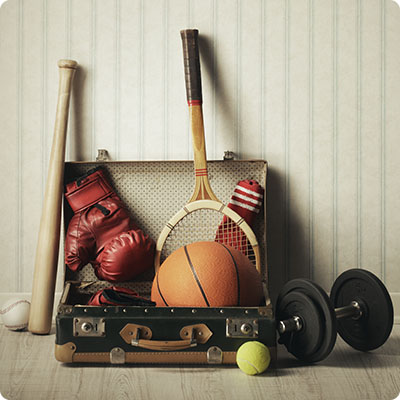Langue unitaire et dialecte
Comme un rappel de la Révolution française, commence à émerger en Italie dès la fin du XVIIIe siècle l’idée d’une patrie unifiée, et c’est la France encore, sous les traits de Napoléon Bonaparte, qui rebat les cartes en annexant certains Etats du Nord. De soulèvements en déchirements, d’insurrections en guerres d’indépendance, le jeu politique entre nations limitrophes finit par aboutir en 1861 à une Italie proche de celle qui nous est aujourd’hui familière. Mais encore faut-il unir ces peuples dont la différence la plus notable réside dans la multitude des dialectes pratiqués. Le toscan avait jusque-là la faveur des écrivains, déjà Dante, Pétrarque et Boccace, les « trois couronnes », l’avaient privilégié, et il semble naturel de le retenir comme langue unique et nationale. Pourtant, dans cette nation en devenir où une majeure partie du peuple est analphabète, il faut encore créer un pont entre langage écrit et langage parlé.
Un homme va y contribuer et ainsi gagner ses lettres de noblesse, Alessandro Manzoni, qui naît à Milan en 1785 et publie en 1825 son chef-d’œuvre, Les Fiancés, tragique histoire d’amour contrariée. Mais il n’est pas satisfait de cette première version, qu’il juge inaccessible, son toscan étant par trop élitiste. Il décide alors de se confronter au florentino vivo, c’est-à-dire au parler de Florence, afin de retravailler son texte et de le calquer au maximum sur ce qu’il entend. Pour cela, avec l’aide de deux amis, et selon la formule consacrée, il va « rincer ses draps dans l’Arno ». Une version remaniée, simplifiée et définitive paraît en 1840. Manzoni ne s’en tiendra pas à cette action littéraire, en 1868 il s’investira politiquement et socialement en présidant, à la demande du ministre de l’Instruction publique, une commission chargée de diffuser et de promouvoir nationalement le toscan renouvelé, notamment par la distribution de manuels scolaires car tout est à inventer et c’est la nouvelle génération qui servira de tremplin. Son roman deviendra l’un des symboles de l’unification qui est en marche et que l’on désigne sous le terme de Risorgimento, « renaissance » : il l’est doublement, tant par la langue, donc, que par le thème, car les Italiens se sont trouvé un autre point commun, l’attrait pour le romantisme. Son contemporain Andrea Maffei, né à Molina di Ledro dans la province de Trente en 1798, contribuera également à cet élan en donnant traduction de certains grands auteurs romantiques, tels que Lord Byron ou Victor Hugo. Il sera par ailleurs librettiste pour Giuseppe Verdi, célèbre compositeur qui, pour saluer la mémoire de Manzoni décédé en 1873, lui dédiera un Requiem l’année suivante.
Pourtant, entre choisir une langue commune et l’imposer, il y a un gouffre - ainsi c’est seulement en 1999 qu’un décret explicite que la langue officielle de la République est l’italien - et la question se pose, par exemple, dans le Val d’Aoste. Le lieu se prête déjà aux divergences comme en témoignent les très vifs débats qui opposeront le chanoine Félix Orsières (1803-1870) et ses pairs, notamment son homologue Léon-Clément Gérard, au milieu du XIXe siècle. L’histoire avait pourtant bien commencé puisqu’ensemble ils participèrent à l’aventure du premier journal régional, La Feuille d’annonces d’Aoste, créé en 1841. Félix est un homme instruit, il est diplômé en droit, a voyagé, et publie en 1839 son Historique du Pays d’Aoste, qui sera bientôt suivi d’une Théorie des améliorations à introduire en cette province. Convaincu qu’il faut lutter contre l’isolement de la vallée, ouvrir des routes, favoriser le développement économique et culturel, tout en insistant sur le rôle que l’Eglise doit tenir dans ces évolutions, ses vues libérales se heurtent violemment aux idées conservatrices de Léon-Clément qui décide de rejoindre le journal opposant nouvellement créé, L’Indépendant.
La bataille de clochers se terminera par la menace d’excommunication de Félix, qui devra se faire discret, mais échauffera l’inspiration de Léon-Clément qui laissera à sa mort, en 1876, plusieurs milliers de vers, dont certains très affirmés. C’est dire si la situation est déjà tendue quand se joue le rattachement à Turin en 1861. La fin du XIXe siècle rimera avec une forte émigration, comme un présage de l’italianisation forcée qu’entreprendra l’Etat fasciste au milieu du XXe siècle et qui aura également de sombres répercussions. Désormais, l’italien et le français cohabitent légalement dans cette région bilingue qui jouit d’un statut spécial confirmant son autonomie.
Pourtant, c’est une troisième langue qui a donné naissance aux plus belles pages du Val d’Aoste : le valdôtain, idiome franco-provençal. Jean-Baptiste Cerlogne, prêtre et linguiste qui fut également prisonnier durant la première guerre d’indépendance après avoir été ramoneur à Marseille, écrit à 29 ans, en 1855, un poème en patois, L’Infran produggo. Il ne sait pas encore qu’il commence une œuvre qui le rendra tout autant célèbre que son travail à venir sur un dictionnaire et sur une grammaire valdôtains. Sa chanson La Pastorala (1884) résonne toujours lors des messes de Noël en Vallée d’Aoste, et sa vie a fait l’objet d’une biographie par René Willien (1916-1979), autre écrivain de renom. La littérature en dialecte, bien que le territoire ait traversé des évènements dramatiques, est restée vivace, nous pourrions citer Eugénie Martinet dite Nini (1896-1983) qui s’épanouit dans une langue qui n’était pourtant ni celle qu’on parlait dans sa famille ni celle qui lui avait été enseignée à l’école, André Ferré, né à Saint-Vincent en 1904, ou - plus près de nous - Raymond Vautherin de La Thuile, et Marco Gal, décédé à Aoste en 2015.Le XXe siècle
L’année 1902 salue à Turin la naissance de Carlo Levi. Diplômé de l’université de médecine, il préfère se consacrer à la peinture et surtout à la lutte contre le fascisme qui peu à peu ronge le pays. Arrêté en 1935, il est condamné à l’exil en Italie méridionale et à la résidence surveillée dans le petit village d’Aliano. De ces deux années, qui le marqueront au point que sa dernière volonté sera d’être inhumé là-bas après sa mort survenue en 1975, il ramènera un livre, l’un des plus grands et plus beaux classiques de la littérature italienne, Le Christ s’est arrêté à Eboli, à se procurer aux éditions Folio. Dans cette autobiographie parue juste après la Seconde Guerre mondiale, il raconte une région délaissée et des habitants abandonnés à leur sort, et dans un style inouï il se fait chantre de la misère et de la désolation.
Un autre témoignage, publié en 1947 par son presque homonyme Primo Levi, né également turinois en 1919, vient lui aussi bouleverser les lecteurs, bien que le premier tirage reste confidentiel et qu’il faudra attendre une quinzaine d’années pour que sa voix soit enfin entendue. Si c’est un homme décrit la déportation à Auschwitz qu’a subie l’auteur en février 1944 et la survie à l’intérieur du camp d’extermination. Après son retour miraculeux, Primo Levi semble redémarrer une vie normale, il rédige ce texte avec le soutien de Lucia, sa future épouse, qu’il vient de rencontrer, reprend le travail, devient père pour la première fois en 1948. Pourtant, il lui est impossible d’oublier, comme le monde autour de lui paraît prêt à le faire, alors il commence alors à militer. Son premier texte est réédité en 1958, traduit en anglais puis en allemand, il attaque la rédaction de La Trêve qui raconte son périple pour rentrer en Italie, publiée en 1963. Il bénéficie d’une écoute et d’une reconnaissance, la presse enfin parle de lui mais, malgré tout, cette année est marquée par les signes annonciateurs d’une dépression dont il ne sortira jamais. Primo Levi continuera d’écrire, de voyager, de donner des conférences, de faire en sorte que l’on n’oublie pas l’impensable et l’insurmontable. Il perdra la vie en 1987 dans une chute d’escalier que beaucoup pensent volontaire.
La mort de Cesare Pavese, le 27 août 1950 à Turin, ne laissera quant à elle pas de place au doute, l’homme s’est suicidé, comme le confirme le mot qu’il laisse dans sa chambre à l’Hôtel Roma, la dernière phrase de son ultime roman, La Mort viendra et elle aura tes yeux, et une note dans son journal intime qui sera publié deux ans plus tard sous le titre Le Métier de vivre. Une courte vie, à peine 42 ans, et pourtant une œuvre immense, dense et aussi éternelle que celle de l’un de ses contemporains, Dino Buzzati, né en Vénétie en 1906. Il est tentant de rapprocher les recherches littéraires de ce dernier de celles de Kafka, tant par la question de l’absurdité de la vie qu’elles semblent soulever que par le côté fantastique de certaines de ses nouvelles, mais il y a un détail qui trop souvent échappe, la passion inconditionnelle que Buzzati portait aux Dolomites. L’écrivain les aura beaucoup parcourues, ses montagnes, vantant leur quiétude et leur magnificence, et si ce sont peut-être elles que l’on discerne en toile de fond de son célèbre Désert des Tartares, elles sont sans aucun doute le décor de son premier roman, Bàrnabo des montagnes. En 2010, une loi a été promulguée en Vénétie autorisant la dispersion de ses cendres dans la nature, Buzzati repose enfin là où il le désirait.
Le paysage hypnotise les hommes, certains veulent s’y confronter et deviennent alpinistes, dans leur sac ils ramènent des récits et naît alors une littérature de la grimpe. Citons par exemple Cesare Maestri qui a vu le jour en 1929 à Trente et Reinhold Messner né en 1944 à Bressanone dans le Tyrol du Sud. Enfin, Paolo Cognetti, milanais de naissance, s’est offert une échappée en Val d’Aoste qu’il raconte dans Le Garçon sauvage, et a obtenu le Prix Médicis étranger pour Les Huit montagnes en 2017. Ces deux ouvrages, traduits avec talent et délicatesse par Anita Rochedy, sont disponibles respectivement chez 10/18 et au Livre de poche.